révolution française
chapître XL à L
joris Abadie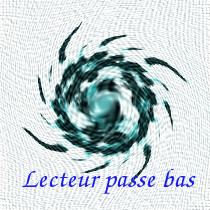
joris Abadie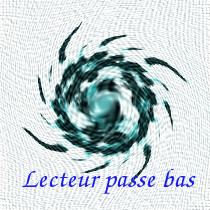
Il y eu un moment où l'on put croire que la politique de la terreur allait s'apaiser et se ramener à une politique sévère encore, mais relativement humaine et sensée. Ce fut une illusion.
Attaqué lui-même par les violents, le Comité de Salut public crut devoir se défendre et les frapper ; mais vainqueur, il se retourna contre ceux qui demandaient la clémence, et il osa frapper les têtes les plus illustre de la Révolution.
A cette époque, le Comité se composait de neuf membres : quatre d'entre eux, Carnot, Prieur de la Marne, Robert Lindet, Cambon, étaient les travailleurs, les administrateurs, les hommes pratiques du Comité. Barère en était l'orateur officiel auprès de la convention ; Collot d'Herbois et Billaud-Varennes en étaient les agents auprès des clubs et du parti démagogique. La pensée politique était surtout résumée dans Robespierre, assisté du jeune fanatique Saint-just et du paralytique Couthon ; ces trois hommes, unis dans un étroit accord de pensées, composaient ce que l'on commençait à appeler tout bas le Triumvirat.
Danton, imprudemment, avait refusé de faire partie de ce conseil.
Quelque gage que l'on puisse donner à la démagogie, il y a toujours un parti démagogique extérieur qui n'est pas satisfait. Le Comité de Salut public, si violent qu'il pût être, avait encore le sentiment de l'ordre et de la règle ; c'était un gouvernement terrible, mais c'était un gouvernement.
Il se forma donc en dehors de lui un parti de brouillons impatients, déréglés, grossiers, composé des plus vils et des plus ineptes éléments, critiquant la Convention et le Comité lui-même, et rêvant, sans trop de préméditation, un nouveau mai. Hébert en était le journaliste, Vincent et Ronsin les chefs militaires, Pache l'idole imbécile. L'ignoble journal du Père Duchesne, écrit en langage des halles, répandait les idées dans la populace. Ce parti en comptait sur la Commune, espoir de tous les révolutionnaires depuis l'origine de la Révolution.
Ce parti anarchique était odieux à Robespierre, qui était avant tout un homme de gouvernement, quand le gouvernement était entre ses mains.
Il lui était odieux encore par un autre endroit : ce parti était athée et affichait l'athéisme. Chaumette, procureur de la Commune, et Anacharsis Clootz, fanatique allemand, avaient inventé le triste culte de la Raison. Notre-Dame avait été fermée au culte catholique, et l'on y avait célébré le fête de la Raison.
Robespierre, au contraire, poussait le déisme jusqu'à l'esprit de secte : il méditait déjà un culte nouveau, et il était fort scandalisé de celui de Chaumette. Il se montra à cette occasion le défenseur de la tolérance ; de concert avec Danton, il flétrit les « mascarades religieuses » de la Commune et fit rouvrir les églises.
Robespierre crut donc devoir frapper un grand coup contre ces exagérés qui mettaient en péril son propre pouvoir et scandalisaient ses principes. Hébert, Chaumette et Clootz furent frappés et envoyés à l'échafaud ( 24 mars 1794 ). La foule suivit de ses huées ces lâches adulateurs de son ignorance grossière, et répétait en riant, comme faisait Hébert tous les vendredi dans son Journal : « Il est b… en colère le Père Duchesne ! »
Ce coup frappé, il semblait qu'il n'y eût plus d'obstacle à l'établissement d'un gouvernement modéré, et Robespierre l'eût probablement inauguré si on lui eût laissé l'honneur d'en prendre l'initiative, et si des attaques imprudentes n'eussent à la fois menacé son influence et blessé son prodigieux orgueil.
Un écrivain admirable, le plus spirituel, le plus éloquent pamphlétaire de la Révolution, l'un de ses violents et de ses plus dangereux amis, Camille Desmoulins, venait, dans son Vieux Cordelier, demander l'établissement d'un Comité de clémence. Il empruntait à Tacite une peinture sanglante dont l'application n'était que trop claire ; et il décochait contre Robespierre et Saint-Just, ces âmes noires et vindicatives comme celles des dévots fanatiques, des traits perçants qui devaient se retourner contre lui.
Danton se taisait ; mais son silence était désapprobateur ; et l'on disait que dans son intérieur il ne ménageait pas les sarcasmes et les critiques. Du reste, paresseux et nonchalant, las déjà de la Révolution, il avait laissé le champ libre à son redoutable adversaire, en se retirant à la campagne.
Une autre raison animait Robespierre et Saint-Just contre Danton et Camille Desmoulins ; non seulement ceux-ci commençaient à devenir suspects de modérantisme ; mais on les accusait d'aimer le plaisir, la vie facile, de ne dédaigner ni le luxe ni les ornements de la vie.
Au contraire, une nouvelle doctrine commençait à se faire jour dans les discours de Robespierre et de Saint-Just. Ce n'était pas seulement pour sauver la Révolution, pour sauver la République que la terreur était nécessaire ; c'était pour faire régner la vertu. Leur idéal était une république, une autorité rigide : quelque chose de semblable à ce que Calvin a établi à Genève dans sa République ecclésiastique.
Ainsi l'esprit de secte animait Robespierre contre Danton aussi bien que contre Chaumette : comme les hommes de l'inquisition, il se croyait le droit d'imposer la foi et la vertu par le fer et par le feu.
Devant cette ténacité implacable, l'énergie intermittente et déjà fatiguée de Danton devait succomber, et avec lui le dernier espoir des indulgents.
Robespierre obtint de la servilité de la Convention et de celle des tribunaux révolutionnaires la tête de son puissant adversaire, et en même temps celle de son brillant ami Camille Desmoulins, à qui il sera beaucoup pardonné, pour avoir, quoique à une heure tardive, plaidé la cause de la pitié. Hérault de Séchelles, l'auteur de la Constitution de 93, fut condamné en même temps. Ils furent exécutés le 5 avril 1794.
Pour les compromettre dans l'opinion, on avait associé leur cause à celle de quelques misérables, coupables de honteuses spéculations, parmi lesquels malheureusement se trouvait un homme de talent, Fabre d'Eglantine, célèbre auteur du Philinte de Molière.
Avec Hébert et Danton furent frappés à la fois les deux partis de l'exagération et de la clémence, du désordre brutal et de la liberté des mœurs, de ceux qui voulaient, suivant l'expression de Saint-Just, changer la Liberté en bacchante, ou en prostituée.
Robespierre n'était pas seulement un politique ; c'était un croyant. Nourri des oeuvres de J.J. Rousseau. Il avait puisé sa politique dans le Contrat social, et sa religion dans l'Emile et le Vicaire savoyard.
Cette religion était le déisme, c'est-à-dire la religion naturelle, sans révélation, réduite à deux dogmes : l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme.
Il avait tonné aux Jacobins contre l'athéisme et prononcé cette parole célèbre : l'athéisme est aristocratique. Il avait fait condamner cette secte avec Hébert, Chaumette, Anacharsis Clootz ; il avait flétri la fête de la Déesse Raison célébrée à Notre-Dame, sous le patronage de Chaumette et de la commune de Paris ; il avait été jusqu'à défendre aux Jacobins la liberté des cultes, même du catholicisme, contre les violences fanatiques d'un nouveau genre.
Il lui restait à proclamer son propre culte : c'est ce qu'il fit à la Convention dans un de ses discours les plus étudiés, vrai pastiche de Rousseau, à la suite duquel il proposa à la Convention le décret suivant qui fut adopté le 18 floréal ( 7 mai 1794 ) :
Article premier. Le peuple français reconnaît l'existence de l'Etre suprême et l'immortalité de l'âme.
Article 2. Il reconnaît que le culte le plus digne de l'Etre suprême est la pratique des devoirs de l'homme.
Ainsi, une Assemblée politique, s'érigeant en concile, proclamait un dogme et constituait une nouvelle religion d'Etat !
Après cette proclamation, le décret établissait une fête de l'Etre suprême. Elle devait avoir lieu pour la première fois le 20 prairial suivant ( 8 juin ).
Elle eu lieu en effet : ce fut le triomphe de Robespierre, et en même temps le signal de sa chute.
Il avait affecté, dit-on, dans l'espèce de procession solennelle qui eut lieu, de marcher seul plusieurs pas en avant de ses collègues du comité. D'autres disent que ce furent ces collègues mêmes qui, jaloux de la prépondérance qu'il avait usurpée, s'étaient efforcés de le compromettre en l'isolant, et en le forçant d'afficher ainsi ses prétentions à la dictature.
Des insultes partirent du sein même de la Convention, et il entendit retentir à son oreille les mots que Mirabeau avait rendus célèbres : « La Roche Tarpéienne est près du Capitole. »
Ainsi s'annonçaient les premiers symptômes de l'orage qui se formait contre lui, et qui, en le terrassant lui et son parti, allait délivrer la France du régime exécré qu'elle subissait.
Ceux qui prétendent que Robespierre, s'il eût triomphé au 9 Thermidor, eût établi lui-même le système de clémence et de modération qui a prévalu après cette époque, oublient que c'est lui qui a présenté, rédigé, fait adopter malgré elle à la Convention la loi du 22 prairial, le plus infâme monument de tyrannie que le monde ait subi depuis Tibère et Néron.
Il ne voulait, dit-on, que frapper les derniers débris de la faction de Danton et de celle d'Hébert ; et alors il eût établi un gouvernement régulier. Ne semble-t-il pas entendre le farouche Louis XI disant à la Vierge : « Encore un petit crime, ma bonne Vierge ; mais ce sera le dernier. »
A moins d'exterminer toute la France, comment aurait pu faire Robespierre pour qu'il n'y ait plus ni Royalistes, ni Girondins, ni Dantonistes, ni Hébertistes, ni violents, ni modérés ?
Bien loin de s'arrêter dans ses vengeances, il était fatalement entraîné dans une voie de plus en plus sanglante, puisque les ennemis croissaient avec les victimes.
A côté de la loi du 22 prairial, la loi des suspects était une loi de clémence et d'humanité. La loi des suspects permettait des défenseurs aux accusés : la loi nouvelle les supprimait.
La loi des suspects exigeait des témoins : la loi nouvelle permettait de s'en passer, en cas de preuves matérielles ou morales.
La loi des suspects ne donnait la faculté de poursuivre qu'au gouvernement ; la loi nouvelle investissait de cette faculté non seulement les Comités et la Convention, mais l'accusateur public Fouquier-Tinville, qui pouvait ainsi à lui seul désigner la victime qu'il était chargé de poursuivre.
La loi des suspects laissait plusieurs degrés de peines : la loi nouvelle n'en connaissait plus qu'une seule, la mort.
Cette loi terrible, votée sous le couteau, par la Convention consternée, ne fut pas seulement une menace, elle fut immédiatement exécutée, et alors commença à Paris et dura pendant deux mois encore un épouvantable massacre, où toute autre justice avait disparu, et qui frappait non pas seulement les nobles, les riches, les émigrés, les bourgeois, mais jusqu'aux classes populaires elles-mêmes décimées par un insensé fanatisme.
Ainsi pratiquée, la Terreur ne pouvait plus être appelée un système de gouvernement : c'était une folie furieuse.
Le principal coupable ici est évidemment Robespierre ; et ce n'est qu'avec justice que la postérité associe son nom à cet abominable régime. Il en est le responsable, car c'est lui qui l'a provoqué par la loi de prairial dont il a été l'auteur réfléchi et l'avocat impitoyable ; il en est responsable, car il était alors incontestablement l'âme du Comité et de la Convention ; il en est responsable : car au moins eût-il pu mitiger dans la pratique l'exécution de la loi, et la tenir suspendue comme une menace sur la tête de ses ennemis, tandis qu'il en abandonna l'exécution à son exécrable agent Fouquier-Tinville, dont la férocité stupide connaissait aussi peu les conseils de la politique, que les réclamations de la pitié.
Le mal était à son comble ; le châtiment ne pouvait tarder.
Ce ne fut pas, comme on pourrait le croire, l'humanité et la pitié qui eurent l'honneur de mettre fin, par un généreux soulèvement, à la tyrannie de la Terreur : ce fut la peur coalisée avec la jalousie. Ce furent les plus criminels eux-mêmes qui renversèrent celui qu'ils appelaient le tyran, et avec lui leur propre système.
Le Comité de Salut public, qui depuis plusieurs mois n'avait pas été renouvelé et exerçait la dictature, était divisé en trois partis distincs : Carnot, Prieur ( de la Côte-d'Or ), Robert Lindet, ne s'occupaient que d'affaires et étaient étrangers à toute lutte politique. Robespierre, Saint-just et Couthon formaient un triumvirat, qui, par une sorte de distinction intellectuelle et d'affection morale, affichaient la supériorité sur leurs trois autres collègues, Barère, Collot d'Herbois et Billaud-Varennes, le premier sans conviction et sans autorité, les deux autres démaguofues féroces et grossiers qu'une jalousie haineuse commençait à animer contre le dictateur.
Un autre Comité, autrefois rival du Comité de Salut public, mais depuis entièrement subordonné et effacé, le Comité de sûreté générale, composé lui-même de Jacobins effrénés, commençait à trouver pesant le joug de Robespierre, et à comploter dans l'ombre avec les adversaires de celui-ci au Comité de Salut pubic.
Enfin, à la Convention, tous les anciens amis de Danton se sentant observés, et voyant surtout dans la loi de prairial une menace de tous les instants, commencèrent également à s'entendre, à se concerter, à se préparer à la résistance.
Le plus important de ces Dantonistes, celui qui a joué le premier rôle dans la chute de Robespierre, était Tallien, qui lui-même à Bordeaux avait donné d'affreux exemples. Mais l'amour d'une femme l'avait assoupli et apaisé. Elle lui avait inspiré la clémence; et maintenant qu'elle était elle-même en prison; il avait à la sauver : c'était Madame de penay, Mademoiselle Cabarrus, depuis la célèbre Madame Tallien.
Robespierre, miné dans l'ombre, avait fait la même faute que Danton. Il s'était retiré du Comité, et pendant deux mois il cessa d'y assister ; c'était laisser le champ libre à ses ennemis.
Averti du complot qui se tramait, il revint en toute hâte, rappela Saint-Just qui était aux armées, et se prépara à frapper un grand coup.
Il était encore tout-puissant ; aux jacobins, il n'avait rien perdu de son prestige. La Convention tremblait devant lui. La Commune lui était dévouée, et le commandant de la force armée, Henriot, était un de ses instruments.
S'il avait osé donner le signal de l'insurrection, la Convention surprise eût sans doute capitulé ou succombé. Il préféra l'arme qui lui était familière, la parole : elle se brisa entre ses mains.
Ecouté le 8 thermidor avec un silence glacé, il fut le lendemain condamné lui-même au silence par une Assemblée furieuse qui avait enfin secoué le joug. La parole lui est refusée. De toutes parts, on demande son accusation. Il essaye de se faire entendre : sa voix expire dans sa gorge. " Le sang de Danton t'étouffe," lui crie-t-on. Il avait vécu.
Robespierre et son frère, Saint-Just, Couthon et Lebas sont décrétés d'accusation, ainsi qu'Henriot, le commandant de la garde nationale.
Le rôle du dictateur était fini à la Convention ; mais un mouvement populaire pouvait encore le sauver. La commune s'était déclarée pour lui. Elle l'avait fait délivrer ainsi que ses amis : elle faisait marcher les sections de Paris contre la Convention.
Mais les temps n'étaient plus où les masses obéissaient sans partage aux ordres révolutionnaires. Entre les deux autorités de la Commune et de la Convention, beaucoup hésitaient : la peur seule les retenaient encore.
Ce fut la peur la plus grande qui l'emporta. La mise hors la loi prononcée par la Convention était encore une arme terrible ; devant ce mot magique, les soldats abandonnèrent Henriot, marchèrent contre ceux qui les avaient envoyés et se rangèrent sous les ordres du député Barras, que la Convention avait chargé du commandement. Ils ressaisirent les prisonniers. Robespierre essaya de se tuer d'un coup de pistolet, et ne se fit qu'une blessure affreuse.
Le lendemain, 10 thermidor, il fut exécuté avec Couthon et Saint-Just, sur la place où il avait fait périr tant de malheureux, laissant après lui une mémoire qui sera éternellement controversée.
Robespierre n'a eu aucune trace de génie. On ne peut lui attribuer aucune de ces mesures sages et pratiques dont l'honneur revient aux Cambon, aux Carnot, aux Robert Lindet, aux Prieur de la Côte-d'Or. Il n'a pas même eu l'initiative des grandes mesures révolutionnaire, qui pour la plupart sont le fait de Danton. Il n'a été que le théoricien et le doctrinaire de son parti. Orateur habile, mais sans naturel, sans mouvement et sans feu, il a eu cependant au plus haut degré l'art de dominer les assemblées par la parole : telle a été la partie la plus réelle de son talent et la seule cause de sa puissance politique.
On doit lui faire honneur de la dignité de ses moeurs et de son incorruptibilité ; mais l'austérité n'a jamais été incompatible avec la perfidie, l'hypocrisie et la cruauté.
Robespierre a eu les vertus et les vices d'un moine fanatique du moyen âge. Il était fait dans un autre temps pour être l'avocat de l'Inquisition. Ambitieux, jaloux, perfide, il était capable de tout pour la plus grande gloire de ses idées. On l'aimerait mieux moins austère, et plus généreux.
Avec le 9 Thermidor finissent les temps héroïques de la Convention. Son existence se prolonge cependant quatorze mois encore ; elle est encore troublée et orageuse ; mais ce n'est plus la grandeur tragique des mois précédents. Elle s'assagit, devient un gouvernement relativement modéré, et laisse après elle une Constitution libérale et pondérée.
Les évènements qui se dégagent dans cette seconde période de l'histoire de la Convention sont : la réaction thermidorienne, l'insurrection jacobine de Prairial et l'insurrection royaliste de Vendémiaire.
Le 9 Thermidor, quels qu'aient été les mobiles de ceux qui en avaient été les auteurs, devait être et fut la fin du système de la Terreur. Les prisons furent ouvertes ; d'innombrables accusés furent mis en liberté ; l'échafaud ne fut plus en permanence, et les exécutions cessèrent.
Le Comité de Salut public, accusé de dictature, fut renouvelé, et ses pouvoirs furent amoindris et partagés.
Les comités révolutionnares furent partout dissous ; le club des Jacobins fut fermé, et ses séances interdites. Les Montagnards, les Terroristes, tous ceux qui étaient plus ou moins suspects de complicité avec le régime de Robespierre, sans avoir eu la prévoyance de se faire Thermidoriens, remplirent à leur tour les prisons.
Cette réaction eut même des excès criminels, qui rappelèrent les plus odieux crimes de la Révolution ; et l'on vit dans le Midi, à Lyon, à Nîmes, à Avignon, à Marseille, des bandes royalistes, sous le nom de Compagnies de Jéhu, renouveler dans les prisons et dans les rues mêmes les massacres de septembre.
Il est inexact cependant et historiquement faux de comparer ce que l'on appelle la Terreur thermidorienne à la Terreur révolutionnaire.
Les crimes des bandes du Midi ne sont pas imputables au gouvernement de la Convention. S'il y eut beaucoup d'arrestations, il y eut peu d'exécutions, sauf dans les premiers jours. Plus tard Carrier, Lebon, Fouquier-Tinville sont à peu près les seuls que l'on puisse mentionner ; et ces monstres, qui s'étaient fait un jeu de l'assassinat, ne méritent nulle pitié. Collot d'Herbois et Billaud-Varennes, les principaux auteurs du 9 Thermidor, victimes eux-mêmes du mouvement qu'ils avaient provoqué, ne furent condamnés qu'à la déportation.
Après le mouvement de prairial, six députés furent condamnés et exécutés et méritent la pitié, pour le courage noble et héroïque qu'ils montrèrent en mourant { Ce sont Romme, Goujon, Duquesnoy, Duroy, Bourbotte, Soubrany.}, surtout lorsqu'on les voit frapper par des mains qui elles-mêmes étaient ensanglantées. Mais ces députés s'étaient rendus complices de l'insurrection, ou tout au moins l'avaient acceptée ; et leur mort doit être considérée comme le châtiment d'un nouvel attentat contre la représentation nationale, et non comme le seul résultat de la réaction.
Il reste donc parfaitement vrai que le 9 Thermidor a été l'affranchissement de la France. Les exès individuels, les expiations légitimes et quelques emportements exagérés ne doivent pas modifier l'opinion légitime que la France s'est faite de ce mouvement libérateur. { Le caractère de cet ouvrage ne se prête en aucune façon à la controverse. Nous devons donc nous borner aux indications précédentes. Il y eut des excès, cela n'est pas douteux ; mais le fait évident, éclatant, incontestable, c'est qu'à partir du 9 Thermidor, l'échafaud cessa d'être en permanence. Le régime de l'assassinat légal a donc fini avec Robespierre. }.
Le 9 Thermidor, en amenant un certain relâchement dans le gouvernement, dut provoquer le déchaînement des factions.
Les Jacobins, exclus du pouvoir, poursuivis dans leurs personnes,suspendus dans leurs moyens d'action, durent, pour ressaisir la fortune, essayer de leur ressource habituelle, l'insurrection : de là la journée de Prairial ( Une première émeute, moins grave, avait eu lieu le 12 Germinal ( 1er Avril ) ).
Les royalistes à leur tour, délivrés de la Terreur, rendus à la liberté, commençant à respirer, recommencèrent à conspirer ; et profitant de l'horreur qu'avait inspirée à la bourgeoisie la dictature montagnarde, ils tentèrent à leur tour un mouvement insurrectionnel : de là le 13 Vendémiare.
Ainsi deux insurrection : l'une jacobine en prairial, l'autre royaliste en vendémiare, signalent la seconde période de l'histoire de la Convention.
L'une et l'autre eurent pour occasion et prétexte la Constitution : l'une la Constitution de 93 ; l'autre, la Constitution de l'an III, que la Convention avait substituée à celle de 93.
On se rappelle que la Constitution de 93 avait été suspendue aussitôt que votée. Les Montagnards, alors maîtres du pouvoir, n'avaient pas voulu un appel au peuple qui eût pu changer le gouvernement ; et ils avaient eu raison.
Mais aujourd'hui écartés du pouvoir, ils réclamaient l'exécution de cette Constitution, qui était redevenue leur espérance. La Convention, par la même raison, ne voulait pas de cette constitution qu'elle considérait comme démagogique.
La politique ne fut pas la seule cause du mouvement de Prairial ( 20 mai 95 ) ; il s'y joignit une autre cause plus pressante et plus cruelle : le défaut de subsistances.
L'insurrection se fit donc au double cri : Du pain ! et la Constitution de 93 ! Les femmes s'y joignirent aux hommes et n'y montrèrent pas moins d'acharnement.
La convention fut envahie par une foule armée, ses délibérations furent suspendue. Le député Féraud fut massacré et sa tête portée au haut d'une pique. L'intrépide Boissy-d'Anglas, président de l'Assemblée, supporta pendant six heures les attaques des furieux, les baïonnettes et les fusils dirigés contre lui.
La Convention fut délivrée par les sections ; et ce fut alors que la réaction contre les Jacobins pris le caractère le plus sévère.
Bientôt, les royalistes enhardis essayèrent une tentative analogue.
La constitution de 93, à la suite des journées de Prairial, avait été décidément rejetée et avait fait place à une Constitution nouvelle, la Constitution de l'an III, beaucoup plus sage que la précédente. Cette Constitution venait d'être soumise à l'approbation des assemblées primaires. La Convention allait terminer son rôle.
Mais avant de se séparer, par crainte des royalistes et pour sauver la Révolution, elle avait décrété que les deux tiers de la nouvelle Assemblée devaient être pris dans le sein même de la Convention ; et ces décrets, annexés à la Constitution, avaient été soumis avec elle au vote des assemblées primaires.
Ce furent ces décrets qui provoquèrent l'insurrection royaliste du 13 Vendémiare : on les considéra comme une tentative de perpétuer la dictature révolutionnaire.
Cependant la France, dans les assemblées primaires, avaient accepté les décrets en même temps que la Constitutiton ; mais à Paris, où la majorité commençait à tourner du côté des royalistes, les décrets furent rejetés.
La jeunesse dorée, les muscadins, comme on les appelait, affichaient insolemment, dans les rues de Paris, le retour aux moeurs aristocratiques et le mépris de la démocratie. Bientôt des entreprises plus menaçantes éclatèrent et furent sur le point de réussir.
Vaincues par le suffrage, les sections de Paris en appelèrent aux armes. Près de 40.000 hommes s'armèrent contre la Convention.
Elle fut sauvée par un jeune général qui avait déjà, par une idée heureuse, décidé de la prise de Toulon, et qui par la décision et l'énergie put, malgré l'infériorité du nombre, refouler de toutes parts l'insurrection. C'était le général Bonaparte.
Barras, le même représentant qui, au 9 Thermidor, avait pris le commandement des troupes et décidé la victoire, avait été encore cette fois chargé du commandement supérieur ; et c'était lui qui avait désigné Bonaparte pour lui servir de second. Il reconnut hautement que c'était à celui-ci qu'appartenait le succès de la journée.
Ce fut rue Saint-Honoré, près de l'église Saint-Roch et même sur ses degrés, qu'eut lieu le plus fort de la lutte. L'artillerie de Bonaparte foudroya les sectionnaires, et sauva la Convention.
Le 13 Vendémiairefut la défaite définitive du parti royaliste, qui ne devait plus retrouver son heure de fortune qu'avec les malheurs de la France.
La Convention, sous prétexte de reviser la Constitution de 93, en fit une toute nouvelle, qui se distinguait de celle-ci et aussi de celle de 91 par ces caractères importants. On l'appela la Constitution de l'an III ( 1795 ).
Cette Constitution naturellement était républicaine, on ne pouvait en attendre une autre de la Convention ; mais l'esprit démocratique y était très tempéré.
Elle établissait :
1° Le suffrage à deux degrés. Les citoyens réunis en assemblées primaires nommaient les électeurs qui devaient nommer les députés.
2° Deux chambres, le Conseil des Cinq-Cents, et le conseil des Anciens ; le premier ayant l'initiative des lois, les seconds la sanction. Ces deux conseils, outre cette différence d'attribution, se distinguaient par le nombre et l'âge de leurs membres. Ils composaient le pouvoir législatif.
3° Un Directoire, composé de cinq membres nommés par les deux conseils chargés du pouvoir exécutif.
4° Le renouvellement annuel des deux conseils par tiers, et du Directoire par cinquième.
5° La réunion de plein droit des assemblées primaires le premier prairial de chaque année.
6° Enfin un pouvoir judiciare électif.
Ainsi cette Constitution se distinguait de la Constitution de 93 :
1° en conservant le suffrage à deux degrés, tel qu'il était sous la Constituante.
2° En ne donnant aucune part du pouvoir législatif aux assemblées primaire, qui ne restaient plus chargées que des élections.
Elle se distinguait de la Constitution de 91 :
1° par la suppression du pouvoir unique et héréditaire ;
2° par l'établissement des deux chambres ;
3° par le principe du renouvellement partiel ;
4° en ce qu'elle n'admettait pas la responsabilité des ministres, simples agents du pouvoir exécutif.
Enfin elle se distinguait de la Constitution républicaine des Etats-Unis en confiant le pouvoir exécutif à plusieurs et non à un seul.
Sauf la composition vicieuse du pouvoir exécutif, qui dans un grand pays se concilie difficilement avec la multiplicité des personnes, cette Constitution était bonne et semblait concilier à la fois la sagesse et la liberté.
Mais les Constitution sont peu de chose quand elles ne sont pas le résultat des moeurs et du temps. En temps de révolution, les hommes ont plus d'importance que les institutions.
L'intérêt tragique que représente l'histoire de la Convention a souvent fermé les yeux sur son oeuvre législative. Cette oeuvre est considérable.
La Convention a continué et achevé l'oeuvre de la Constituante. Elle a surtout contribué à fixer l'établissement de l'unité nationale.
Avant la Révolution, la France était régie par un grand nombre de législations diverses. Elle était divisée d'abord en deux grands groupes, pays de droit écrit ou de droit romain, pays de droit coutumier. En outre, il y avait autant de coutumes que de provinces. La Convention, comme la Constituante, a travaillé à la fusion de toutes les lois et de toutes les coutumes ; elle a jeté les fondements de ce qu'on a appelé plus tard le Code Civil. Elle a préparé ainsi l'unité juridique.
Toutes les provinces avaient leur système de mesures. Dans l'Anjou seul, on employait 98 mesures différentes pour le grain. La Convention fonda l'unité des poids et mesures, en établissant le système métrique.
Les créances envers l'Etat reposaient sur toutes sortes de titres différents, et avaient des origines diverses. La Convention unifia la dette nationale en créant le Grand-Livre, où tous les créanciers étaient inscrits et confondus.
Sous l'ancien régime, les corps savant ou Académies vivaient d'une vie indépendante et séparée. La Convention, après les avoir dissoutes, les fit renaître et revivre sous le titre de Classes et en les réunissant en un corps unique qui fut l'Institut.
L'Institut est un gouvernement fédératif dans lequel chacune des classes ( qui ont repris depuis le nom d'Académies ) est souveraine dans son domaine propre, mais liée aux autres par des intérêts communs, des assemblées communes, un bureau commun ; en un mot elles représentent dans la diversité des différentes sciences l'unité du savoir humain.
Aux quatre Académies qui existaient dans l'ancien régime ( Académie française, Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des sciences, Académie des beaux-arts ), la Convention en ajouta une cinquième, qui répondait aux besoins de la société nouvelle, la Classe des Sciences morales et politiques.
Supprimée sous le Consulat comme suspecte d'idéologie et d'indépendance politique, cette classe fut rétablie en 1832 par M.Guizot, sous le gouvernement de Juillet.
Parmi les créations scientifiques de la Convention, il faut citer encore les suivantes : le Museum, corps savant institué au Jardin des plantes pour l'enseignement des sciences naturelles ; l'Ecole polytechnique, chargée de préparer une élite de jeune gens aux armes spéciales et aux grands travaux publics ; le Bureau des Longitudes, l'Ecole des langues orientales, le Conservatoire de Musique, le Conservatoire des Arts et Métiers.
Elle fit la première loi sur la propriété littéraire. Elle a créé le Bulletin des Lois.
Elle établit à Paris, une Ecole normale, qui dura quatre mois : ce fut le premier essai, mais l'essai informe de ce qui devint plus tard l'Ecole Normale supérieure. Elle créa aussi des Ecoles centrales, pour remplacer les anciens collèges. Ces deux créations furent le berceau de notre moderne Université.
Dans ces écoles l'enseignement littéraire fut très faible : le personnel manquait ; mais il n'en fut pas de même de l'enseignement scientifique.
Pour la première fois on vit les plus grands savants ( Monge, Berthollet, Haüy, etc ) devenir professeurs. Ils enseignèrent à l'Ecole normale et à l'Ecole polytechnique les vraies méthodes scientifiques. Cet enseignement forma des hommes qui transportèrent ensuite ces méthodes dans toute la France, les répandirent dans les écoles centrales, et plus tard dans les lycées. La vraie science se substitua à la science caduque et scolastique des anciennes Universités.
On peut donc dire que l'enseignement scientifique, dans l'Université moderne, est l'oeuvre de la révolution et de la Convention.
Devant ces immences services rendus à la cause de l'esprit humain, il est difficile de maintenir contre la Convention l'accusation de vandalisme, que des excès et des désordres populaires inséparables des révolutions ont plus ou moins autorisée. Au contraire, c'est la Convention qui la première a fait une loi pour la conservation des monuments historiques. C'est encore elle qui a organisé le musée du Louvre.
Lakanal, Daunou, Fourcroy, l'abbé Grégoire : tels sont les noms dont la postérité doit conserver le souvenir, et auxquels revient l'honneur de toutes les mesures libérales que nous venons d'énumérer.
On voit qu'elle fut l'oeuvre de la Convention. Une pareille somme de travaux dans les temps antérieurs aurait demandé plusieurs siècles ; ce fut le travail de trois années. La convention ne s'est pas contentée de détruire, elle a fondé et organisé ; et nous jouissons encore aujourd'hui des fruits de son activité législative.
Le désastre de Savenay avait mis fin à la grande guerre de Vendée. A partir de ce moment, ce ne fut plus qu'une guerre de partisans dans le Marais sous le commandement de Charette, et en Bretagne une guerre de brigandage sous le nom de chouannerie.
Cette guerre de partisans se termina par la première pacification de la Vendée, qui eut lieu en 1795.
Charette fit sa soumission, et, avec la facilité d'enthousiasme qui caractérise le peuple français, il fut reçu comme en triomphe dans la ville de Nantes. Bientôt les autres chefs suivirent son exemple.
Ce n'était qu'une paix simulée, c'est-à-dire une trêve. Pendant que Charette négociait, Puisaye, l'organisateur de la guerre des Chouans, préparait à Londre, de concert avec les Anglais et les émigrés, une expédition considérable.
Cette expédition débarqua en Vendée dans la presqu'île de Quiberon, croyant que tout allait se soulever sur son passage, et qu'elle n'avait qu'à marcher devant elle pour reconquérir la Vendée et la Bretagne. Il n'en fut pas ainsi.
La défiance et la division partageaient le parti royaliste.
Rien ne bougea ; des bandes de Chouans indisciplinés vinrent seules se joindre aux troupes de débarquement, et, ne pouvant franchir les lignes républicaines, furent rejetées dans la presqu'île étroite de Quiberon, sous la protection d'un fort que les républicains emportèrent la nuit par surprise ( 20 juillet 95 ).
Ce fut alors un affreux désastre. Précipités dans la mer, les insurgés furent en grande partie détruits. Quelques-uns seulement purent se sauver. Les émigrés pris les armes à la main furent fusillés, conformément aux lois.
Les chefs vendéens qui n'avaient pas bougé lors de l'expédition de Puisaye, relevèrent la tête après sa défaite. Charette, comptant sur une nouvelle expédition de débarquement, cette fois commandée par un prince français, le comte d'Artois, repris les armes ainsi que les autres chefs.
Mais l'expédition, arrêtée à l'Ile-Dieu pendant plus d'un mois, ne débarqua pas, et le prince s'en retourna comme il était venu.
Réduits à leurs propres forces, abandonnés chaque jour par leurs soldats, les deux derniers chefs vendéens, Stofflet et Charette, furent livrés à l'armée républicaine : l'un et l'autre furent fusillés.
L'insuccès des expéditions du dehors, la prise et la mort des chefs insurgés amenèrent la seconde pacification de la Vendée.
Un jeune homme, le général Hoche, déjà illustre par son succès sur les bords du Rhin, avait déployé dans cette guerre les plus grandes qualités militaires et politiques. C'est à lui surtout que l'on dut la fin de cette guerre odieuse, qui divisait la France avec elle-même. Cette seconde paix à la vérité ne fut pas encore elle-même la dernière ; les derniers vestiges de rébellion ne s'éteignirent définitivement que sous le Consulat ; mais la République fut cependant délivrée de ce péril pendant quelque temps, et elle put en toute sécurité ne plus songer qu'à ses ennemis extérieurs.
A la fin de 93, l'invasion était arrêtée sur toutes nos frontières. En 94, elle fut refoulée tout à fait, et la République française devint à son tour envahissante et conquérante.
La campagne de 1794, aux Pays-Bas, vit la marche parallèle de Pichegru le long de la mer du Nord, et de Jourdan le long de la Meuse et de la Sambre.
En Flandre, le général Pichegru et ses lieutenants avaient battu Clerfayt à Mouscron at à Courtray, Cobourg et le duc d'York à Tourcoing, et Clerfayt encore une fois à Hooglède.
Sur la Sambre, Jourdan avait remporté la fameuse victoire de Fleurus ( 27 juin 94 ) , qui, menaçant de couper les communications de l'armée autrichienne, l'avais forcée à la retraite.
La seconde conquête de la Belgique fut la conséquence de cette importante bataille.
Bientôt, Jourdan poussait les Autrichiens devant lui, les refoulait de la rivière de l'Ourthe à celle de la Roër, et de celle-ci sur le Rhin, dont il devenait le maître jusqu'à Cologne.
De son côté, Pichegru passait la Meuse et arrivait devant le wahal, c'est-à-dire encore le Rhin, que nous avions ainsi atteint sur toute la ligne de l'est à l'ouest.
Tels étaient les résultats de la campagne de 94.
Au Midi, le général Dugommier avait, du côté de l'Espagne, refoulé l'ennemi jusqu'au delà des Pyrénées. Il était mort victorieux à la bataille d'Escola. Du côté de l'Italie, la général Dumerbion, dirigé par Bonaparte, avait fait quitter aux Piémontais le camp de Saorgio, et les avait forcés de se replier au delà des Alpes.
Ainsi le territoire était délivré : la conquête de la Savoie et de Nice assurée. Voilà pour le Midi.
Quant au Nord, la puissance française s'étendait jusqu'au Rhin.
Un dernier coup d'éclat vint l'année suivante jeter la terreur en Europe. Ce fut l'invasion et la conquête de la Hollande.
Pichegru entrait à Amsterdam, le 20 Janvier 95, et après avoir passé le Zuyderzée sur la glace, il faisait prisonnière la flotte hollandaise. Il dut à l'hivers d'achever cette conquète que Louis XIV et Dumouriez avaient manquée.
A la suite de ces brillants succès, les deux traités de Bâle ( 25 avril et 14 juillet 1795 ), et celui de La Haye ( 15 mai ), dissolvaient la première coalistion, et désarmaient trois de nos ennemis, la Prusse, l'Espagne et la Hollande.