HISTOIRE DE LA REVOLUTION
FRANCAISE
SUITE XXXI
joris Abadie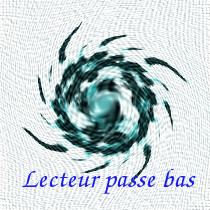
joris Abadie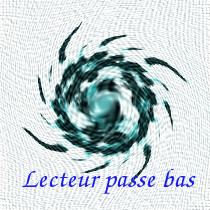
Du 20 septembre 1792 au 2 juin 1793, l'histoire de la Convention n'est que l'histoire de la lutte entre la Gironde et la Montagne, et du progrès croissant du parti révolutionnaire.
Les Girondins, depuis le 10 août, avaient le ministère, quoique Danton y fut entré, et que Roland en fût sorti ; ils avaient la majorité dans la Convention : on peut donc dire que le gouvernement était entre leurs mains ; mais c'était en apparence plus qu'en réalité.
La Montagne avait pour elle les clubs et la Commune, et dans les grandes luttes elle disputait dans l'Assemblée la majorité aux Girondins. Le Centre, en effet, ou, comme on l'appelait, la plaine, craignant de trop favoriser un parti aux dépens de l'autre, oscillait entre les deux.
La Gironde, prévoyant qu'il fallait vaincre ou périr, prit l'offensive à la tribune de la Convention. Louvet, dans une philippique célèbre, accusa Robespierre de prétendre à la dictature. Mais il était trop tôt ; cette attaque fut sans résultat. Il en fût de même d'une première attaque dirigée contre Marat.
Le procès de Louis XVI mit encore aux prises les deux partis. Au fond, les girondins auraient voulu sauver le roi : ils échouèrent, et n'eurent pas même l'honneur de leur propre opinion, qu'ils abandonnèrent au vote final.
Ils réussirent à faire voter des poursuites contre les meurtriers de septembre ; mais ces poursuites, qui menaçaient de trop puissantes têtes, furent bien vite abandonnées.
Une nouvelle tentative d'attaque eut lieu contre Marat, qui, dans son journal l'Ami de peuple, avait conseillé le pillage des magasins de consommation au peuple exaspéré de la cherté des subsistances. Le pillage eut lieu, et Marat fut décrété d'accusation par la Convention ; mais cette fois encore l'accusation fut abandonnée. Ainsi échouaient toutes les tentatives de la Gironde pour écraser ses adversaires et dominer la situation.
Bientôt, au contraire, ce furent les adversaires qui reprirent l'avantage, non seulement au dehors, mais au sein même de la Convention.
Les derniers échecs des armées en Belgique et en Hollande avaient de nouveau exaspéré la fureur du parti populaire : pour le satisfaire, l'Assemblée vota, le 10 mars 1793, l'établissement d'un Tribunal révolutionnaire, nommé par la Convention et jugeant sans appel. Danton fut un de ceux qui contribuèrent le plus à l'établissement de ce tribunal terrible. Plus tard il en demanda pardon à Dieu et aux hommes, quand il en fut devenu la victime.
La défection de Dumouriez amena une nouvelle concentration du pouvoir, et l'établissement du Comité de salut public ( 6 avril ). Ce furent les Girondins qui le proposèrent, mais ce fut aux Montagnards qu'il servit d'instrument. Ce Comité, composé de neuf membres, devait seulement avoir la haute surveillance sur le pouvoir exécutif ; mais le temps n'était pas éloigné où il allait devenir lui-même ce pouvoir tout entier. Les premiers noms des députés qui le composèrent n'appartenaient guère, sauf celui de Danton, qu'à des hommes de second ordre. Cependant Cambon en faisait déjà partie ; il devait être, comme chacun sait, le financier de la Convention.
Si les Girondins eussent été habiles politiques, ils se fussent ménagé l'alliance de Danton, qui mieux que personne, comprenait la nécessité de ne pas déchaîner la Révolution. Mais séparés de lui par l'abîme des journées de septembre, ils repoussèrent ses avances avec hauteur et mépris.
Accusés par Robespierre de complicité dans l'affaire de Dumouriez, ils osèrent renvoyer l'accusation à Danton, dont la mission auprès de Dumouriez n'avait pas en effet été très claire. Guadet, orateur mordant, ne craignit pas de lancer les traits les plus sangmants contre le terrible démagogue : « Ah ! tu m'attaques, s'écria Danton, tu ne connais pas ma force ! » Ce fut un ennemi de plus.
Cependant le parti montagnard, après, avoir repoussé les attaques de la Gironde, après avoir entraîné la Convention par l'adoption des grandes mesures révolutionnaires, commençait à penser à un dessein plus audacieux : celui de chasser ses adversaires de L'Assemblée nationale, et de les frapper par un grand coup.
Le 10 Août avait été une insurrection contre la royauté. Le 30 Mai et le 2 Juin furent une insurrection contre la Convention. Les Girondins avaient été les instigateurs de la première ; ils furent les victimes de la seconde. Ainsi la révolution marchait déjà de coup de force en coup de force jusqu'au jour où, par un châtiment inévitable, elle tomberait entre les mains d'un soldat heureux.
Le 10 mars, un premier complot, tramé par les Jacobins et les Cordeliers, menaça l'Assemblée ; mais ce complot échoua ; un bataillon de fédérés de Brest dispersa les conjurés.
Le 15 avril, une réunion de délégués des sections, le maire Pache en tête, vint porter une pétition à la barre de l'Assemblée, demandant l'exclusion de vingt-deux députés, c'est-à-dire des principaux Girondins. Cette pétition fut repoussée avec indignation.
Marat fut encore une fois l'objet des attaques du côté droit. Il avait, dans son journal, excité à l'insurrection contre la Convention. Cette fois, l'Assemblée se décida à le décréter d'accusation et à le citer devant le Tribunal révolutionnaire. Mais il fut acquitté par le Tribunal, et cette accusation maladroite fut pour lui l'occasion d'un nouveau triomphe.
Un moment la Gironde fut sur le point de l'emporter. Guadet proposa, comme mesure de salut, de casser et de remplacer la municipalité de Paris. La Convention, sous l'influence de Barère, se contenta de nommer une commission des douze pour rechercher les complots. C'était déclarer la guerre à la Commune sans l'avoir abattue.
Danton, jusqu'alors neutre, se voyant renié et repoussé par les Girondins, se tourna contre eux.
Agitation populaire contre la Commission des douze ; suppression de cette Commission par un coup de vote surpris par les Montagnards ; annulation de ce vote le lendemain par un vote contraire ; appel et préparation à l'insurrection : tels sont les événements qui du 26 au 31 mai préparèrent le coup décisif.
Ce coup, comme celui qui avait frappé Louis XVI, eut deux actes : le 31 Mai et le 2 Juin. Le premier fut, comme on l'appela, une insurrection morale ; le second, un coup d'Etat de la multitude.
Le 31 Mai, l'insurrection était déjà armée ; mais elle n'alla pas jusqu'à la violence : elle se contenta de la menace. Barère et Danton proposèrent de ramener la paix par la suppression définitive de la Commission des douze. Robespierre, allant plus loin, voulait frapper ses ennemis. Ce fut l'opinion modéré qui l'emporta. La Commune était victorieuse ; mais la Convention n'était pas profanée et mutilée.
Ce n'était pas assez. Le 2 Juin, Marat prit la direction de l'insurrection. Cette fois, elle fut dirigée contre la Convention elle-même, qui vota sous le canon. Opprimée et humiliée, chassée d'abord par le peuple, comme elle le fut plus tard par les soldats au 18 Brumaire, la représentation nationale ne reprit sa séance que pour décréter d'accusation vingt-sept députés. Ainsi, la foule, sachant à peine ce qu'elle faisait, donnait elle-même le premier exemple de la violation du pouvoir législatif par la force armée.
Avec le 2 Juin, le rôle parlementaire des Girondins était terminé. Il ne leur restait plus que deux partis à prendre : combattre ou mourir.
Pour achever leur histoire, racontons ces deux actes du drame.
La guerre civile avait éclaté en France avant le 31 Mai : déjà la Vendée avait pris les armes, et le Midi commençait à s'agiter. Mais les événements de Paris donnèrent une impulsion rapide et énergique au mécontentement des provinces, et en quelques jours la Convention vit s'élever contre elle jusqu'à soixante-dix départements.
L'insurrection contre la Convention obéissait à deux esprits différents. Dans la Vendée, à Marseille, à Toulon, elle fut royaliste. En Normandie, à Bordeaux, à Lyon même, elle fut en général girondine et républicaine.
Ce fut le malheur de la Gironde d'être en quelque sorte, malgré elle, complice d'une réaction royaliste.
Parmi les Girondins frappés par les décrets du 2 Juin, les uns voulurent rester à Paris, attendant le jugement qui devait être leur mort ; ce furent Vergniaud, Gensonné, Ducos, Valazé, et avec eux Mme Roland ; les autres partirent pour soulever kes provinces ; Buzot en Normandie ; Brissot à Moulins ; Meilhan et Duchatel en Bretagne ; Birotteau à Lyon ; Rebecqui à Marseille.
Leur premier centre de ralliement fut Caen. Là se réunirent Pétion, Barbaroux, Guadet, Louvet, Buzot, Lanjuinais. Ils formèrent une Assemblée des départements, organisèrent une armée sous les ordres du général Wimpfen. En même temps, Lyon, Marseille et Bordeaux prenaient les armes.
Si tous ces élément séparés eussent réussi à se concerter et à se joindre, c'en était fait de la Convention.
Mais l'éloignement où étaient les uns des autres les centres d'insurrection, les divisions d'opinion qui séparaient plus encore que les distances, la lenteur et la mollesse des classes moyennes, donnèrent à la montagne le temps de prendre les mesures les plus énergiques.
Le comité de Salut public, par l'organe de Gambon et de barère, proposait des moyens de conciliation. Robespierre et Danton, toujours unis, entraînèrent encore une fois la Convention dans la voie de la Révolution. Bien loin de rétracter le 2 Juin et de faire aucune concession aux départements, elle proclama que le peuple avait bien mérité la patrie, et que les départements qui ne se rétracteraient pas dans les vingt-quatre heures seraient mis hors la loi.
Cette menace seule suffit pour désarmer immédiatement un grand nombre de départements soulevés ; contre les autres, la Convention se décida à employer la force.
La victoire des Conventionnels à Pacy-sur-Eure, près de Vernon ( 14 juillet 93 ), dispersa l'armée de Caen, la seule des armées de l'insurrection qui eût quelque consistance. La Normandie et la Bretagne rentrèrent dans la soumission et les Girondins furent contraints de se retirer sur Bordeaux ; mais quand ils y arrivèrent après beaucoup de périls, ils trouvèrent la ville aux mains du parti montagnard, et Tallien y faisant régner le régime révolutionnaire. Le centre même du fédéralisme, comme on appelait alors le parti girondin, leur échappait.
Dans le midi, le général Cartaux, avait empêché la jonction des Marseillais et des Lyonnais, et mis en fuite un corps de Nîmois envoyés en avant. Bientôt après, il était entré dans Marseille.
Ainsi, la Gironde, vaincue à Paris, l'était maintenant en France. Elle succombait sous de faux prétexte et de fausses accusations. On l'accusait de fédéralisme, c'est-à-dire de l'opinion qui voulait établir en France une république fédérative ; mais cette opinion, innocente d'ailleurs en elle-même, n'avait jamais été celle du parti. On l'accusait de vouloir rétablir la royauté : et elle était très sincèrement républicaine ; on l'accusait de complicité avec Dumouriez et Philippe d'Orléans : et elle n'avait jamais eu aucune relation ni avec l'un ni avec l'autre. Philippe-Egalité était bien plus près de la Montagne que de la Gironde.
Les Girondins méritent la sympathie pour avoir essayé de maintenir la Révolution dans les voies de la modération, de la liberté et de l'humanité. Sans doute, s'ils eussent triomphé, ils auraient été précisément dans la même situation que les Montagnards eux-mêmes : ils auraient eu une insurrection royaliste à étouffer, un parti montagnard à contenir, la guerre étrangère à refouler, et il est douteux qu'ils eussent pu remédier à tous ces maux sans une sorte de dictature ; mais cette dictature eût été moins sanglante, elle aurait respecté davantage le droit et la liberté ; elle n'aurait pas laissé à la République la tache infamante que 93 lui a imprimée, et qui a été depuis le principal obstacle à son établissement définitif dans notre pays.
Toutes les révolutions ont leurs fanatiques ; tous les partis ont leurs martyrs. Jamais le fanatisme n'a pris de traits plus nobles, plus purs, plus séduisants, que lorsqu'il enflamma le cœur et conduisit la main de Charlotte Corday ; jamais le martyr n'eut de traits plus hideux et plus révoltants que ceux de la victime. Et cependant, il ne faut pas l'oublier, afin qu'aucun parti ne l'oublie : l'assassinat est toujours l'assassinat.
Charlotte Corday, arrière petite-nièce de Corneille, était née dans le Calvados. Elle demeurait à Caen, lorsque les Girondins fugitifs y vinrent organiser la résistance. Elle les admirait avant de les connaître ; elle partageait leur sentiments républicains, et leur horreur pour le sang et pour la tyrannie. On dit même qu'elle eut des sentiments tendres pour l'un d'entre eux, Barbaroux. Révoltée contre la violence qui les chassait de Paris, elle crut qu'il suffirait de frapper le chef des forcenés, pour vaincre la démagogie. Elle partit pour Paris, hésitant si elle prendrait pour victime Robespierre, Danton ou Marat.
Ce fut celui-ci qu'elle choisit comme le plus odieux de tous, comme celui qui avait joué le principal rôle dans la journée du 2 Juin.
Elle alla le trouver chez lui, dans son bain, sous prétexte de délation ; et pendant qu'il inscrivait les noms destinés à l'échafaud, elle le frappait au cœur et attendait, impassible, qu'on la livrât à la prison, c'est-à-dire au supplice.
Elle se présenta devant le Tribunal révolutionnaire avec une dignité simple et noble, avoua tout, revendiqua hautement la responsabilité de son acte, rejeta toute complicité, accepta la condamnation avec la plus courageuse indifférence et mourut avec la même sérénité ; véritable héroïne, si elle fût née à Rome, et non dans un temps où la conscience plus délicate refuse aux particulier le droit de venger par le poignard les injures publiques.
Si elle avait cru, par cet acte néfaste, frapper la démagogie au cœur et sauver la liberté, elle connaissait bien peu les lois des révolutions. Elle ne fit qu'assurer à Marat un triomphe posthume, exaspérer la fureur du parti révolutionnaire, donner un aliment à ses soupçons, et lui fournir un prétexte contre les malheureux captifs dont il demandait la mort.
Robespierre, toujours prêt à servir et à attiser les haines populaires, tira de ce funeste événement sa conséquence logique et fatale : « Le meilleur moyen de venger Marat, dit-il aux Jacobins, c'est de poursuivre impitoyablement ses ennemis. »
L'insurrection vaincue en Normandie, désarmée en Bretagne, à Bordeaux, à Marseille, ne résistait plus que dans trois centres, à Lyon, à Toulon et en Vendée. A Lyon, elle fut d'abord républicaine, mais les royalistes en prirent bientôt la direction ; à Toulon, le parti royaliste dominait ; en Vendée, il était seul et tout-puissant.
La querelle commença à Lyon par une bataille entre la municipalité et les sections : la première était jacobine ; les autres appartenaient au parti modéré. Les sections victorieuses destituèrent la municipalité, envoyèrent à l'échafaud le montagnard Chalier, chef du parti révolutionnaire, et se mirent en révolte ouverte contre la Convention, tout en offrant d'accepter la constitution qu'elle venait de voter.
La convention n'hésita pas, et ordonna le siège de la ville. Il fut confié à Dubois-Crancé, habile officier du génie, qui déjà venait de mettre fin aux troubles de Grenoble. Il détacha une partie de l'armée des Alpes ; et avec es forces, aidées de quelques nouvelles levées, il occupa le cours supérieur de la Saône et du Rhône, au confluent desquels est située la riche cité de Lyon.
Les Girondins lyonnais avaient été expulsés par les royalistes, qui avaient à leur tête Précy et Virieux. Effrayés par les menaces de la Convention et poussés par le parti royaliste, les Lyonnais refusèrent d'obtempérer aux sommations des assiégeants, et le bombardement fut décidé.
Le siège dura deux mois : des forces insuffisantes ne permettaient pas un blocus complet ; bientôt le montagnard Couthon, à la tête de nouvelle levées, menace de l'assaut de la ville affaiblie par une longue résistance, fait révoquer Dubois-Cracé dont la modération lui est suspecte, et obtient enfin la reddition des malheureux Lyonnais, qui, mal informés, avaient refusé de se livrer à son prédécesseur ( 9 octobre 93 ).
La Convention victorieuse rendit contre Lyon un décret terrible qui annonçait d'affreuse représailles : « La ville de Lyon sera détruite ; cette ville cessera de s'appeler Lyon : elle s'appellera Commune affranchie ; sur ses débris sera élevé un monument où seront lus ces mots : Lyon fit la guerre à la liberté. Lyon n'existe plus. »
Les représailles furent atroces. Collot d'Herbois et le célèbre Fouché, depuis duc d'Otrante et ministre de Louis XVIII, y déployèrent la plus odieuse férocité. Non seulement les maisons furent démolies par une sauvage vengeance contre les choses ; mais les personnes furent guillotinées en masse, et comme ce procédé était encore trop lent, Collot d'Herbois employa la mitraille pour massacrer plus d'hommes en moins de temps.
Lyon vaincu, la Convention put concentrer ses forces contre Toulon. Cette ville, après la prise de Marseille par le général Cartaux, était dans le Midi le dernier refuge du parti royaliste.
C'était le malheur de ce parti de ne pouvoir se défendre contre la République sans trahir la Patrie. Il crut tout permis au nom de la royauté, et en proclamant Louis XVIII il livra Toulon aux Anglais.
Ainsi les plus acharnés ennemis de la France étaient appelés sur le territoire par des Français ; le plus redoutable de nos ports était livré à la jalousie et aux ressentiments d'une nation rivale.
Maîtresse de Lyon, la Convention put rassembler de grandes forces autour de toulon. Une armée de trente mille hommes, commandée par Dugommier, en commença le siège dans les règles.
C'est à ce siège célèbre, on le sait, que commença la fortune de Bonaparte. Ce fut à lui que l'on dut l'inspiration décisive qui livra Toulon aux républicains.
Le fort de l'Eguillette commandait la rade : maître de ce fort, on l'était de la ville ; et l'escadre anglaise et espagnole, menacée d'être détruite par le feu des assaillants, devait évacuer la ville infailliblement. Ce fort paraissait imprenable. Bonaparte, par une batterie heureusement placée et que les Anglais ne purent détruire, en rendit l'attaque possible ; un assaut victorieux le livra à nos troupes.
L'amiral anglais se hâta d'évacuer la rade, qui ne lui offrait plus aucune sûreté ; mais il ne voulait pas quitter la ville sans porter un coup fatal à notre marine ; il mit le feu à la flotte française, livrant la ville à l'incendie et les habitants à la fureur des républicains.
Allumé par les Anglais, le feu fut éteint par les forçats.
Fréron et Barras, représentants de la Convention, furent à Toulon ce que Fouché et Collot d'Herbois avaient été à Lyon. La guillotine et la mitraille vengèrent la défection et la trahison de la cité coupable.
La convention était partout victorieuse à l'intérieur ; un seul foyer de résistance luttait encore avec la plus grande énergie et devait arrêter longtemps les efforts des républicains. C'était la Vendée.
Mais revenons au gouvernement de la République après le 31 Mai et le 2 Juin et la victoire définitive du parti montagnard.
Après la chute des girondins, le gouvernement passa entre les mains des Jacobins et de la Montagne : il prit des allures de plus en plus révolutionnaires.
On appelait révolutionnaires les moyens rapides, extrêmes, inusités, exigés, disait-on, par les nécessité critique de la situation, moyens plus ou moins contraires aux règles reçues, aux traditions administratives, juridiques, économiques, trop souvent aussi au droit et à l'humanité.
Le comité de Salut public, qui n'avait d'abord dû être qu'un conseil de surveillance préposé aux ministères, devint peu à peu le centre véritable du pouvoir exécutif ; on lui adjoignit des éléments nouveaux empruntés au parti énergique : ce furent Saint Just, Couthon, Jean-bon Saint André. Puis on le renouvela et on le composa tout entier de membres appartenant au même parti. Robespierre n'y était pas encore.
Les Girondins avaient eu leur projet de constitution, rédigé par Condorcet. La Montagne voulut avoir le sien : Hérault de Séchelles en fut le rédacteur.
Ce fut la célèbre Constitution de 93, votée en huit jours par acclamation, acceptée par la grande majorité des assemblées primaires, mais suspendue aussitôt qu'acceptée et qui n'a jamais été appliquée.
Cette Constitution, la plus démocratique qui ait jamais été proposée à aucun peuple, donnait le suffrage universel sans conditions, confiait le pouvoir législatif à une Assemblée nommée pour un an, et dont les décrets devaient être sanctionnés par les assemblées primaires, confiait enfin le pouvoir exécutif à vingt-quatre membres nommés par le suffrage à deux degrés.
Après avoir fait cette Constitution et l'avoir fait approuver par le peuple, la Convention jugea utile d'en suspendre l'exécution, et elle décréta que le gouvernement resterait révolutionnaire jusqu'à la paix.
A des périls extraordinaires il fallait opposer des moyens qui ne l'étaient pas moins. Elle décréta la levée en masse. Il fallait activer l'héroïsme militaire : la Convention envoya des commissaires aux armées. Il fallait des armes et des munitions : l'industrie et la science furent mises au service de la patrie.
Pour alimenter ces armées, il fallait des ressources promptes, innombrables, qu'on ne pouvait pas attendre du bon vouloir des particuliers ; elle décréta le droit de réquisition.
Il fallait une monnaie : elle multiplia les assignats, dont elle imposa la circulation par tous les moyens les plus arbitraires.
En même temps que l'on forçait à prendre les assignats au taux nominal, il fallait, pour compléter cette mesure, fixer le prix des marchandises : autrement la hausse de l'objet vendu équivalait à la baisse des moyens d'achat : on décréta donc le maximum.
Les assignats ne suffisant pas, on dut avoir recours à des emprunts et on décréta l'emprunt forcé ; mais en même temps, et à côté, on eut soin de conserver un emprunt volontaire beaucoup plus favorable au prêteur : entre ces deux emprunts, l'un forcé et l'autre qui était censé ne pas l'être, mais qui était plus avantageux, la plupart devaient préférer celui-ci.
Il fallait régulariser les dettes de l'Etat, et ramener à l'unité de titre toutes les créances, de quelque date et de quelque origine qu'elles fussent : le financier Cambon fit créer le Grand-Livre.
D'autre résolution, moins en rapport avec les nécessités du moment, mais répondant au besoin d'unité rationnelle, et en même temps de rénovation radicale, qui était la passion du temps, furent prises encore vers ce temps par la Convention nationale. L'une de ces résolutions était excellente, et a été durable : ce fut l'unité de poids et de mesure pour toute la France et l'adoption du système métrique.
Une réforme moins heureuse et moins nécessaire fut le changement du calendrier. On voulut avoir une ère républicaine, un calendrier républicain. L'ère nouvelle commença le 22 septembre 1792 : ce fut l'an I de la République. On divisa l'année en douze mois, qui prirent leurs noms d'après la saison « Voici ces douze mois : Vendémiaire, Brumaire, Frimaire ; Nivôse, Pluviôse, Ventôse ; Germinal, Floréal, Prairial ; Messidor, Thermidor, Fructidor. ». Le mois fut de trente jours et divisé en décades. La semaine fut donc de dix jours au lieu de sept.
Toutes ces mesures, les unes sages et durables, les autres bizarres, d'autres violentes mais exigées par les circonstances, ne dépassaient pas de beaucoup le droit que se sont reconnu tous les Etats, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils se sont sentis menacés dans leur existence. On ne peut nier que par cet ensemble de mesures énergiques, poursuivies avec obstination et imposées par une volonté de fer, la Convention n'ait sauvé la France. Heureux, si elle n'avait pas porté de plus graves atteintes à la conscience humaine !
Mais si on peut pardonner l'arbitraire employé au salut du pays, aucun cœur généreux ne peut pardonner la cruauté.
Par l'abominable loi des suspects, la convention a dépassé la limite qui sépare la dictature de la tyrannie. Elle a égalé et surpassé en inhumanité les plus odieux gouvernements de l'histoire : elle a fait mettre le Comité de Salut public à côté du Conseil des Dix de Venise, des plus mauvais empereurs romains, des tyrans de tous temps.
Crime impardonnable, commis non seulement contre l'humanité et la France, mais contre la République et la révolution elle-même. On ne prépare pas les hommes à la liberté en en faisant des esclaves : on ne prépare qu'une proie facile au despotisme heureux, lorsque son heure sera venue.
La guerre de Vendée était antérieure au soulèvement des Girondins, et n'eu aucun rapport avec lui : les insurgés de Bretagne qui se joignirent aux insurgés de Caen, étaient les mêmes qui combattaient au delà de la Loire les royalistes vendéens.
On appelle guerre de Vendée une insurrection qui s'était déclarée sur la rive gauche de la Loire, non seulement dans la Vendée proprement dite, mais dans le Poitou haut et bas et surtout dans deux régions d'une disposition toute particulière : le Bocage et le Marais.
On appelait Bocage un pays coupé de ravins et de haies, divisé en une multitude de champs et de métairies, sans grandes routes et presque sans villes. Le Marais était un pays marécageux, coupé de canaux et s'étendant du Bocage jusqu'à la mer. Ces deux pays, presque inaccessibles aux grandes armées, étaient singulièrement propres à une guerre de partisans.
Les paysans de ce pays, sur une étendue d'une trentaine de lieues carrées, vivaient loin des idées modernes, dévoués à leurs seigneurs et à leurs curés.
Ils comprirent peu de chose à la Révolution, s'indignèrent lorsqu'on leur enleva leurs prêtres, et se révoltèrent lorsqu'on voulut les forcer à prendre les armes.
Leurs chefs furent à la fois des paysans et des nobles : Cathelineau, Voiturier ; Stofflet, garde-chasse ; La Rochejacquelein, Bonchamp et Lescure, des meilleurs familles du pays, et surtout le plus énergique, le plus habile, le plus tenace et le moins scrupuleux de tous, Charrette, ancien lieutenant de vaisseau, appartenant à une famille d'armateurs de nantes.
L'insurrection éclata à Saint-Florent près d'Ancenis, en Anjou, le 10 mars 1793. A Machecoul, dans le Marais, la révolte commença par le massacre. 300 prisonniers républicains furent fusillés sans jugement.
D'étonnant succès signalèrent bientôt les débuts de ces armées improvisées. Elles s'emparent de Cholet, de Thouars, de Fontenay. Le 7 juin, elles entraient dans Saumur et se rendaient maîtresses de la ligne de la Loire, d'où elles pouvaient, à leur choix, marcher sur Nantes ou sur Paris. Les Vendéens se décidèrent pour le premier de ces deux partis.
Tels avaient été les succès de ce qu'on appelait la grande armée de Vendée. Une autre armée, l'armée du Marais, commandée par Charrette, s'était avancée de son côté jusqu'à Machecoul près de Nantes.
Ainsi Nantes, défendue par me général Canclaux, était à la fois l'objectif des deux armées vendéennes : l'une sur la rive gauche de la Loire, commandé par Charrette ; l'autre sur la rive droite, par Cathelineau. Ce fut là l'écueil où vint échouer cette redoutable insurrection.
La double attaque fut repoussée, Cathelineau fut tué dans l'assaut. L'armée vendéenne se replia. Tout mouvement offensif li était interdit désormais.
Repoussés à Nantes, où ils avaient été vaincus par Canclaux, et en même temps aux Sables-d'Olonne, où ils avaient été vaincus par Boulard, les Vendéens, rentrés dans leur pays, se dédommagent bientôt par une double victoire à Châtillon et à Vihiers, les 5 et 6 juillet 93.
La guerre était dans le camp républicain ; d'une part, le parti démagogique, ennemi de tout ordre, de toute discipline, croyait que l'énergie révolutionnaire suffisait à tout ; de l'autre, le parti militaire rejetait les torts sur l'indiscipline des recrues, le défaut d'ordre et d'organisation. Ronsin et Rossignol étaient à la tête du premier parti, Westermann, ami de Danton, était à la tête du second. Il fit arrêter Ronsin ; mais les derniers échecs rendirent l'avantage aux déclamateurs démagogues. Westermann et Biron, Berthier et Menou, qui commandaient les armées républicaine, furent accusés de trahison et envoyés à Paris pour rendre compte de leur conduite.
Rossignol fut nommé général en chef, avec Ronsin comme adjoint. On décréta en même temps la guerre révolutionnaire, la guerre d'extermination ; mais ce qui fut plus funeste aux Vendéens que cette décision, ce fut l'arrivée sur le théâtre de la guerre de la garnison de Mayence, qui, après un siège héroïque, venait d'obtenir une capitulation honorable, et avait eu tous les honneurs de la guerre avec la seule obligation de ne plus servir pendant un an contre les coalisés. Elle fut envoyée en Vendée. Merlin de Thionville était représentant de la Convention ; Kléber commandait l'armée.
La lutte continua entre le parti démagogique et le parti militaire. Canclaux, excellent général, est destitué pour faire place à Léchelle, aussi incapable que lâche ; heureusement il laisse à Kléber le véritable commandement.
Après des alternatives de succès et d'échecs, les républicains sont enfin décidément vainqueurs à une affaire capitale, à la bataille de Cholet ( 18 octobre 93 ), où les Vendéens perdent l'un de leurs chef les plus brillants, le général de Bonchamp, qui, avant de mourir, sauve la vie aux prisonniers républicains.
C'est alors que la grande armée vendéenne prend une résolution héroïque et désespérée. Mettant à exécution une pensée hardie de Bonchamp, elle traverse la Loire à Saint-Florent-le-Vieil, marche sur la Normandie pour s'emparer d'un port de mer et se mettre en communication avec les émigrés et avec les Anglais.
Ce passage de la Loire, dans les mémoires vendéens, est un épisode des plus émouvants. Ce n'était pas seulement l'armée, c'était la Vendée tout entière, femmes, vieillards, enfants, qui émigrait, chacun emportant avec lui tout ce qu'il possédait. Quatre-vingt mille hommes étaient là sur les bords de la Loire, croyant trouver leur salut sur l'autre bord.
Cet exode fut la ruine du parti vendéen ; mais quelques derniers succès les attendaient encore.. Maître de Laval qu'ils avaient occupé sans coup férir, ils y sont attaqués par les républicains. Le lâche Léchelle donne l'exemple de la fuite, en même temps que son ineptie entraîne l'armée dans une fausse position. La déroute est la conséquence de ses fautes ; et les vendéens, une dernière fois vainqueurs, se décidèrent à marcher sur Granville.
Mais une troupe sans disciple, sans matériel de siège, sans connaissances techniques et topographiques, ne pouvait prendre une place fermée et défendue. Les Vendéens échouèrent à Granville comme ils avaient fait à Nantes.
Dès lors, tout fut malheur, ruine et désastre pour cette malheureuse armée. Les républicains réorganisés en avaient repris la poursuite. Marceau, sur la proposition de Kléber, avait été nommé général en chef. Les Vendéens, après quelques heureux succès à Pontorson et à Dol, essayèrent de passer la Loire à Angers pour rentrer dans leur pays ; mais repoussés, ils retournent vers la Bretagne, errant çà et là et traînant partout avec eux, à la suite de l'armée, toute une population.
Bientôt, ils marchent sur le Mans, dont ils s'emparent facilement, la ville étant ouverte. Mais Marceau vient les y attaquer. Un combat de nuit se livre dans les rues de la ville. Les Vendéens subissent une effroyable déroute.
En fuite de toutes parts, ils se portent sur la Loire pour passer à Ancenis ; mais point de bateaux. Un dernier coup de désespoir les ramène en Bretagne, et là, près de Savenay ( décembre 93 ), ils subissent un dernier et irréparable désastre.
La grande armée vendéenne était anéantie. Charrette seul restait debout.
On appelle la Terreur le régime qui a pesé sur la France depuis la chute des Girondins ( 2 juin 1793 ) jusqu'à la chute de Robespierre ( 9 thermidor – 27 juillet 1794.)
Quelques-uns font commencer ce régime au 10 Août et aux massacres de septembre ; mais le 10 Août était une insurrection, et une insurrection n'est pas un système. Les massacres de septembre avaient été un coup d'Etat odieux, mais pouvaient n'être qu'un épisode isolé ; et au fond c'est ce qu'eût voulu Danton. D'ailleurs, ces massacres étaient, au moins en apparence, condamnés par tous les partis. Même le 21 janvier pouvait encore n'être qu'un épisode sanglant, mais isolé ; enfin, du 10 Août au 31 Mai, il y eut lutte entre les deux systèmes.
Même après la chute des Girondins, le système de la terreur ne s'établit pas tout à coup. Les viles passions populaires le demandaient ; la fausse profondeur politique de Robespierre et de ses amis y poussait la Convention. Mais l'opinion n'était pas encore prête. Il fallut la révolte des départements et la mort de Marat pour entraîner à la fois et étouffer l'opinion. Le parti royaliste et le parti girondin semblaient prendre l'initiative de l'audace. La fureur de la vengeance, le fanatisme du soupçon exaspéré franchirent ce premier pas devant lequel reculent tous les Nérons : nul n'osa plus regarder en arrière, et une fatalité sanglante pesa sur la France.
La première victime fut le général Custine : coupable de fautes militaires, il fut accusé de trahison, et paya pour Dumouriez.
Puis vint la malheureuse Marie-Antoinette : coupable de légèreté, de préjugé monarchique, de haine contre la Révolution et même, il faut dire, de complicité avec l'émigration et l'ennemi du dehors, elle eût dû être sauvée par la pitié. Elle succomba, et la haine démagogique ajouta encore l'ignoble injure à la cruelle expiation.
Puis ce fut le tour des nobles et courageux Girondins. Ils avaient fait la République, et cette République les immolait à ses sanglantes fureurs. Ils disputèrent leur vie pied à pied, peut-être avec plus de ténacité que de dignité. Mais ils furent héroïques dans la mort ; et l'histoire n'oubliera jamais leurs efforts pour sauver les droits de l'humanité et e la liberté.
Vergniaud, Gensonné, Brissot, Sillery, Ducos, Fonfrède, Fauchet, etc., périrent sur l'échafaud. Valazé se tua d'un coup de poignard. Roland, qui s'était évadé de rouen, se tua également après avoir appris la mort de sa femme. Condorcet, qui, caché à Paris, n'avait pas voulu compromettre son hôtesse et s'était sauvé dans la campagne, fut arrêté plus tard et se tua également. Persécuté, chassé, sous le coup des bourreaux, il écrivait cette admirable Esquisse des progrès de l'esprit humain où respire une si noble confiance dans les destinées de l'espèce humaine.
Les femmes elles-mêmes ne devaient pas être épargnées par la fureur révolutionnaire. La brillante Egérie du parti girondin, Mme Roland, fut entraînée dans leur condamnation. Elle s'y montra, comme la plupart des femmes de cette époque, héroïque et sublime. En allant à l'échafaud, voyant une statue de la Liberté, elle prononça, dit-on, ces mots célèbres : « O Liberté ! que de crime on commet en ton nom. ( Pour la plupart des mots ainsi attribués aux héros de la Révolution, il faut les regarder plutôt comme légendaires que comme historiques. Cependant, comme ils sont beaux et souvent cités, nous devons les rapporter.) »
Bailly, l'ancien maire de Paris, savant illustre, vieillard vénérable, mourut à son tour avec une noble fermeté. On sait ce qu'il répondit à un soldat qui lui disait : « Tu trembles. – Oui, c'est de froid. »
Puis vinrent les généraux Brunet et Houchard, coupable de n'avoir pas vaincu ; encore ce dernier avait-il quelques mois auparavant sauvé Dunkerque de l'invasion anglaise.
Age, sexe, gloire, services rendus, opinions républicaines, dévouement à la patrie, rien ne désarmait le terrible Tribunal, instrument des haines et des vengeances populaires. Le fanatisme et la peur étaient coalisés contre les malheureux objets des défiances démagogiques ; dans la crainte d'être victime, on se faisait assassin. Ce fut là la vraie cause qui perpétua si longtemps le gouvernement révolutionnaire.
Si sévère que l'on soit pour la Convention, il ne faut pas oublier qu'elle a sauvé la patrie.
Une part de cette gloire revient évidemment au Comité de Salut public, qui a eu l'initiative et la responsabilité du commandement ; et dans ce Comité il faut aussi, sans l'exagérer, faire sa part à l'illustre Carnot, dont on a dit qu'il avait « organisé la victoire ».
On a contesté cette gloire à la Convention et au Comité de Salut public. On n'a pas voulu qu'un gouvernement si odieux pût avoir un si grand honneur.
Mais si les résultats eussent été malheureux, l'histoire aurait dit que la Convention avait perdu la France ; il faut donc avoir le courage de dire qu'elle l'a sauvée. Raisonner autrement, ce serait soutenir que les gouvernements ne servent à rien.
On ne peut oublier qu'en 93 la France était envahie de quatre côtés à la fois : au Nord, par les Anglais et les Autrichiens ; en Alsace, par les Autrichiens et les Prussiens ; en Dauphiné et jusqu'à Lyon, par les Piémontais ; dans le Roussillon, par les Espagnols. En même temps, la guerre civile à l'intérieur éclatait dans quatre foyers différents : en Normandie, en Vendée, à Lyon et à Toulon. Dire qu'un gouvernement incapable et même, ajoute-t-on, désorganisateur, a pu vaincre, en quelques mois, d'aussi gigantesques périls, c'est admettre un effet sans cause.
Ce n'est point, d'ailleurs, par ses excès criminels que la Convention a sauvé le pays ; c'est par ses grandes résolutions et ses sages mesures.
Comme le général romain, après la bataille de Cannes, la Convention doit être admirée de n'avoir pas désespéré de la patrie ; son intrépidité a relevé les âmes.
Par la décision, la volonté, l'unité de pouvoir, elle a multiplié les ressources, et en a vigoureusement coordonné l'emploi.
Par la levée en masse et par ses mesures financières hardies, mais nécessaires, elle a trouvé des moyens nouveaux et proportionnés à une situation extraordinaire.
Carnot et la Convention ont créé la guerre moderne, celle des grandes masses et des grands mouvements ; par là ils ont vaincu des ennemis timides et routiniers, qui plus tard devaient retourner contre nous-mêmes l'arme terrible dont nous étions les inventeurs.
La sévérité même, quand elle ne dégénérait pas en cruauté, mettait chacun dans la nécessité de faire son devoir. Les commissaire de la convention mettaient le feu aux armées.
Sans doute, beaucoup de désordres, d'erreurs, de violences inutiles et mêmes cruelles venaient se mêler à ces mesures du gouvernement et de ses agents ; mais ces maux étaient compensés par les avantages que présentait un gouvernement énergique, patriote, fertile en ressources, merveilleusement obéi.
Si le Comité de Salut public eût connu la clémence, il eût été un des plus grands gouvernements de l'histoire ; mais son fanatisme, égal au moins à son patriotisme, en a fait un des plus exécrés.
Excusable encore s'il n'eût obéi qu'au fanatisme et si l'ambition et la peur n'en eussent fait l'esclave d'une multitude féroce qu'il méprisait !
Ainsi, dans cette histoire terrible, on est toujours déchiré entre deux sentiments contradictoires, l'horreur et l'admiration.
Ce qui autorise à être sans pitié pour les excès de la Révolution française, c'est qu'à plusieurs reprise elle a eu occasion de s'arrêter dans sa voie de politique implacable, et qu'elle ne l'a pas fait.
Les massacres de septembre étaient un crime abominable et sans nom ; mais ce coup terrible une fois porté, et après avoir fait peur aux royalistes, la Révolution pouvait s'arrêter comme tant d'autres gouvernements après un coup d'Etat heureux et sanglant.
La mort de Louis XVI était sans doute contraire à l'humanité et à tous les droits ; mais enfin c'était frapper à mort la royauté, braver l'Europe ; et cette tête unique et privilégiée une fois tombée, la Révolution pouvait respecter les citoyens.
L'expulsion des Girondins était un attentat odieux à la souveraineté nationale ; mais enfin, si la raison d'Etat exigeait leur défaite, la Révolution pouvait se contenter de les désarmer, et gouverner sévèrement et énergiquement, mais sans fureur et sans barbarie.
L'exécution des Girondins, de ces hommes courageux et généreux qui avaient fondé la République, était une chose lamentable ; mais enfin ils avaient pris les armes, et leur parti avait donné l'exemple de l'assassinat. On pouvait encore, après avoir frappés, revenir à un gouvernement rigoureux mais modéré.
La loi des suspects était une loi abominable ; mais enfin la guerre est la guerre ; attaqué au dedans et au dehors d'une manière furieuse, un gouvernement est excusable de se livrer à certains excès pour sa défense ; seulement, on pouvait retenir les prisonniers sans les exécuter ; si l'on allait jusqu'à la cruauté, on pouvait au moins choisir de rares victimes, et non faire des hécatombes réglées. Enfin, la patrie une fois sauvée, on pouvait arborer le drapeau de la clémence.
A chacune de ces occasions, l'humanité et la sagesse politique commandaient au comité de s'arrêter ; et il passait outre chaque fois plus entraîné dans sa politique sanglante.
Ce qui le condamne encore plus, c'est que le prétexte qu'il invoquait devait s'éterniser : il fallait frapper, disait-il, les ennemis de la Révolution ; mais chaque coup qu'il frappait augmentait le nombre de ces ennemis, et le crime enfantait le crime.
En résumé, la Convention aurait pu se contenter de la dictature sans aller jusqu'à la tyrannie : cette tyrannie eût pu aller jusqu'à l'arbitraire sans aller jusqu'à la cruauté ; cette cruauté aurait pu se contenter d'un ou deux ou trois coups une fois frappés, sans devenir systématique ; enfin cette cruauté eût pu être systématique et fanatique, sans devenir insensée et ignoble comme elle le fut à Lyon, à Nantes, à Arras et même à Paris dans les derniers mois de la terreur.
Ainsi, la Convention est passée insensiblement de l'arbitraire à l'injustice, de l'injustice à la violence, de la violence à la cruauté, de la cruauté enfin à une ivresse frénétique qui n'a plus de nom dans aucune langue.
Un homme essaya d'arrêter cette progression effroyable, dont il avait été lui-même un des premiers instigateurs ; mais il y périt à son tour : ce fut Danton.