Abandon de tous les privilèges
joris Abadie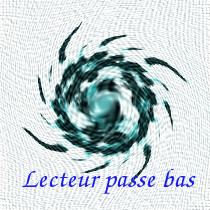
joris Abadie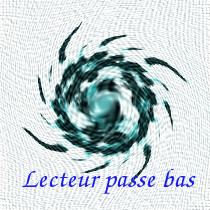
La révolution française est la révolution qui a achevé en France et commencé en Europe l'abolition de l'ancien régime.
Il ne faut pas confondre l'ancien régime avec l'ancienne France.
L'ancienne France, c'est la France, une dans tous les temps par la communauté des gloires et des douleurs. C'est la Patrie.
L'ancien régime est un ensemble d'institutions qui ont existé, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, dans l'ordre de la propriété, de la famille, de l'administration civile, de l'organisation politique. C'était le régime féodal avec l'absolutisme monarchique.
Ces institutions, après avoir répondu pendant un temps à des nécessités historiques, avaient fini par dégénérer en abus insupportables qui peuvent se résumer en deux mots : privilèges et arbitraire.
Les privilèges sont les droits que les uns possèdent aux dépens des autres. L'arbitraire, c'est le pouvoir d'un seul ou de quelques-uns sur tous, sans règle et sans lois.
De là, deux sortes de cause de la Révolution : les unes sociales, les autres politiques ; les unes naissant de l'inégalité des classes, les autres de l'absolutisme monarchique.
Comme la Révolution a eu deux causes, elle a eu également deux buts : détruire l'inégalité ou le privilège, détruire le despotisme ou l'arbitraire.
Quelques-uns ont pensé que la Révolution a eu raison d'abolir les privilèges, mais qu'elle devait laisser subsister le pouvoir absolu, seule garantie, suivant eux, de l'égalité.
D'autres, au contraire, ont pensé que la Révolution a eu raison d'abolir l'arbitraire du pouvoir, mais qu'elle aurait dû laisser subsister l'inégalité des classes, seule garantie, suivant eux, de la liberté.
C'est là une double erreur. La grandeur de la Révolution a été précisément de poursuivre à la fois et de ne pas séparer ces deux objets qui sont le complément garantie l'un de l'autre : l'égalité et la liberté.
Résumons d'abord les causes sociales de la Révolutions française.
La principale cause de la Révolution a été l'excès de l'inégalité.
Il y a deux sortes d'inégalités parmi les hommes : les unes naturelles, telles que l'âge, la santé, l'intelligence, la vertu, etc. ; les autres artificielles et arbitraires, telles que l'exemption d'impôts, le droit exclusif à certaines fonctions, etc.
L'ancien régime reposait sur d'innombrables inégalités de cette seconde classe.
La nation était divisée en trois classes ou ordres : la noblesse, le clergé et le tiers état.
La noblesse et le clergé ne contribuaient à l'impôt que dans une mesure inégale et insuffisante.
Le principal poids des charges publiques portait sur le tiers état, particulièrement sur les paysans.
Le clergé n'était tenu qu'à des dons gratuits qu'il fixait lui-même arbitrairement. La noblesse payait la capitation ou impôt par tête, plus ce qu'on appelait l'impôt du vingtième, établi sous Louis XV par le contrôleur général Machault. Mais le tiers état payait lui-même ces deux sortes d'impôts, et de plus il payait seul la taille, qui était pour le Trésor la principale source de ses revenus.
Outre la taille, le peuple des campagnes était encore soumis à la corvée « La corvée était l'obligation de donner gratuitement plusieurs jours de travail pour l'entretien des routes. ». De là l'expression célèbre de gent taillable et corvéable à merci, par laquelle le tiers état avait été longtemps qualifié.
La noblesse, outre le privilège d'être exempte de la taille, avait encore celui de pouvoir s'élever seule aux grades militaires.
Dans la plupart des provinces, les droits territoriaux passaient de mâle en mâle par droit d'aînesse, et les sentiments naturels de la famille recevaient par cette inégalité de graves atteintes.
Le clergé prélevait sur le produit des terres une partie, appelée dîme ou dixième, et jouissait d'immenses propriétés, dites biens de mainmorte, biens incommutables et inaliénables, qui étaient soustraits à la libre circulation.
Non seulement les ordres privilégiés étaient affranchis en partie des contributions publiques, mais ils profitaient même de ces contributions ; et un grand nombre de courtisans ne vivaient ne vivaient que sur les pensions et les faveurs de la couronne, alimentées par le travail du tiers état.
Enfin ces ordres privilégiés prélevaient eux-mêmes, à titre de droits féodaux, une grande partie de la richesse social ; les paysans étaient accablés de charges fiscales. Ces charges avaient pu à l'origine, lorsque le seigneur était souverain, représenter des services rendus ; mais elles avaient perdu avec le temps toute signification, et n'étaient plus qu'une oppression ruineuse pour les campagnes et l'agriculture.
Les principaux de ces droits étaient les rentes féodales de toute nature ; les banalités, ou obligation de moudre au moulin du seigneur, de cuire à son four, de se servir de son pressoir ; les corvées seigneuriales, distinctes de la corvée due à l'Etat ; les droits exclusifs de colombier, de pêche, de chasse ; enfin une multitude d'autres dont les noms mêmes n'ont plus de signification pour nous.
Même la servitude personnelle existait encore dans certaines provinces : par exemple, les cerfs de Saint-Claude dans les montagnes du Jura. Ces serfs n'avaient ni la faculté de tester, ni celle de changer de domicile, ni celle de choisir un état à leur gré. A leur mort, leur pécule retournait entre les mains du seigneurs ; et si les biens venaient à être vendus, les serfs pouvaient être partagés « comme un vil bétail… comme s'ils eussent éré vendus par des pirates ( Cahiers du Tiers Etat en 1789, t. III, p. 335.) ».
La justice était rendue à prix d'argent : les charges de judicature étaient vénales, comme aujourd'hui nos offices ministériels, et elle se transmettaient par hérédité : on s'élevait ainsi à une demi-noblesse, que l'on appelait la noblesse de robe.
Le tiers état lui-même avait des privilèges. Les diverses industries formaient des corporations fermées dont on ne pouvait franchir les limites ; le travail, enfermé ainsi dans des barrières infranchissables, ne pouvait faire aucun progrès. En même temps, les maîtrises et les jurandes, par toutes sortes de restrictions oppressives, empêchaient l'ouvrier de s'élever jusqu'à la condition de maître.
Enfin, lors de l'avènement du roi Louis XVI, le servage n'était pas aboli dans toute la France ; la torture était encore infligée aux accusés ; l'état civil était interdit aux protestants ; les douanes intérieures empêchaient la libre circulation des denrées.
Tel était l'ensemble des abus qui duraient depuis des siècles, et que le développement des lumières avait rendus intolérables avec le temps.
Annotations A.P.J. : La question posée en ce jour de mai 2003 est : est-ce que la décentralisation ne détruit pas la garantie d'équité nationale ? Ne va-t-on pas retrouver des baronnies s'appuyant sur les courtisans des temps modernes ? Avons nous réussi l'objet de la révolution en supprimant tous les privilèges ?
La Révolution, avons-nous dit, a deux buts : abolir les privilèges aristocratiques, abolir l'absolutisme monarchique.
La royauté française, après avoir lutté pendant de longs siècles contre le pouvoir de la féodalité, était enfin parvenue, sous Henri IV et le Cardinal de Richelieu, au pouvoir absolu.
Les grands vassaux qui, au moyen âge, jouissaient d'un pouvoir presque égal à celui du roi, et qui exerçaient dans leurs domaines tous les droits de la souveraineté, avaient été obligés de plier l'un après l'autre devant la royauté.
Le clergé, qui partageait avec les grands les pouvoirs féodaux, avait aussi perdu peu à peu toute puissance politique, et n'était plus qu'un clergé de cour asservi et obéissant.
Les villes qui avaient conquis sur les seigneurs leurs libertés communales, les avaient vues peu à peu disparaître confisquées par la royauté.
Une grande institution, les Etats généraux, dont nous parlerons plus amplement, et qui étaient composés des trois ordres ( noblesse, clergé, tiers état ), convoqués pour voter des subsides aux princes, n'avaient été appelés que dans des cas d'extrême péril ; et l'on avait fini par s'en passer tout à fait.
Le parlement, cour de justice, qui avait quelques prérogatives politiques, entre autres le droit d'enregistrer les édits, c'est-à-dire les volontés royales, et le droit de remontrances, le Parlement avait essayé d'étendre ces prérogatives et de devenir une assemblée délibérante, chargée de contenir le pouvoir royal. Il fut vaincu dans la guerre civile de la Fronde, et les dernières tentatives de résistance et de liberté publique succombèrent avec lui.
La liberté individuelle n'avait aucune garantie. Des lettres de cachet obtenues à prix d'argent ouvraient les prisons d'Etat, non seulement aux rebelles, mais à tous ceux que poursuivaient le caprice et la passion des puissants.
La liberté de la presse était nulle, au moins légalement. Tout dépendait de l'arbitraire. L'Emile de J.J. Rousseau était brûlé par la main du bourreau.
Le règne de Louis XIV avait été le triomphe du despotisme. Pouvoir sans frein et sans contrôle, désordre de mœurs insolemment affiché. Les nobles devenus courtisans, les parlements serviles allant jusqu'à légitimer les enfants adultérins du roi, tout vestige de liberté disparu, les protestants chassés de France, un régime de guerres perpétuelles qui, après un temps de splendeurs, avait fini par mettre le royaume à deux pas de la ruine et dont nous payons encore aujourd'hui les conséquences « On demandait en 1870 à un grand historien allemand, après la chute de l'empereur : Mais à qui donc faites-vous la guerre maintenant ? il répondit : A Louis XIV. » : tel est le bilan de ce grand règne.
Cependant Louis XIV avait été pendant quarante ans le maître de l'Europe, et ses désordres avaient eu au moins quelques apparence de dignité. Mais son successeur Louis XV laissa tomber l'influence de la France, perdit notre puissance coloniale, et assista impassible au partage de la Pologne.
Sous le même prince, comme sous le duc d'Orléans, qui avait été régent pendant sa minorité, les désordres majestueux du roi Louis XIV furent remplacés par les vices les plus bas et la plus honteuse dissolution.
Il acheva de ruiner les finances de la France de déconsidérer le pouvoir, et sut être à la fois arbitraire et puissant.
Il mourut méprisé, détesté, emportant avec lui le dernier prestige de la monarchie.
Louis XVI, petit-fils de Louis XV, monta sur le trône en 1774. C'était un prince honnête et faible, qui eut peu de lumière, montra de bonnes intentions, fit de grandes fautes et paya pour toute sa race.
Cependant le commencement de son règne furent heureux. Il eu d'abord pour ministres quelques bons et honnêtes citoyens : Turgot, Malesherbes, Necker. Quelques réformes sages furent réalisées.
La question fut abolie, et les accusés ne furent plus contrains par la torture à avouer des crimes que peut-être ils n'avaient point commis, ou à dénoncer des complices qui n'existaient pas.
Les douanes intérieures furent supprimées, et les denrées purent circuler librement dans toute la France, d'une province à l'autre.
L'abolition de la corvée, l'affranchissement des derniers serfs qui restaient encore sur le sol de la France, l'état civil rendu aux protestants : telles sont les réformes, préparées par les philosophes, que Louis XVI eut l'honneur d'avoir tentées ou exécutées avant la Révolution.
Cependant quelques-unes de ces réformes ne furent pas immédiatement réalisées. La corvée, rétablie après la chute de Turgot, ne fut définitivement supprimée que sous le ministre de Brienne, en 1787. Les serfs du Jura n'obtinrent pas leur affranchissement complet, puisqu'ils le réclamaient encore en 1789.
Un autre grand événement jette aussi un juste éclat sur les premières années du règne de Louis XVI ; ce fut la guerre d'Amérique.
Les colonies anglaises d'Amérique insurgées contre l'Angleterre soutenaient depuis 1773 une lutte énergique et opiniâtre. Washington, Franklin, Jefferson, Hamilton, furent les héros de cette lutte. Une partie de la jeunesse française s'engagea sous le drapeau américain, à la suite de La Fayette. Bientôt le gouvernement de la France, entraîné lui-même, prit parti pour les insurgés. Cet appui détermina le succès de la guerre, et, en 1783, le traité de Versailles assura l'indépendance des Colonies, et l'établissement de la grande république des Etats-Unis.
Mais ces premiers succès ne procurèrent au roi qu'une popularité momentanée. Les difficultés s'aggravaient de jour en jour, et présagèrent bientôt une révolution inévitable.
Les courtisans, menacés dans leurs privilèges, dans leurs pensions, dans leurs jouissances, s'opposaient à toute réforme et faisaient renvoyer les ministres qui leur étaient contraires.
La reine, Marie-Antoinette, fille de Marie-Thérèse d'Autriche, imbue des maximes les plus despotiques, exerçait sur le roi une influence des plus malheureuses et combattait tantôt d'une manière ouverte déclarée, tantôt sourdement, toutes les idées nouvelles.
Necker, financier habile, qui avait essayé de mettre de l'ordre dans les finances, fut congédié. Il se retira en publiant un Compte rendu, acte célèbre qui, pour la première fois, mit le public au courant de la politique financière de l'Etat.
Calonne, son successeur, esprit léger, présomptueux, plein de charlatanisme, flatta la reine et les courtisans, répandit les pensions, multiplia les dépenses, et creusa plus profondément le gouffre du déficit.
Pour sortir de ces embarras, il convoqua en 1788 une Assemblée des notables : c'était une assemblée choisie par le roi dans les trois ordres et composée des personnages les plus importants ; ce n'était pas la nation.
Et cependant cette assemblée elle-même n'avait aucune confiance dans Calonne, elle se défiait de son intégrité, ne s'en rapportait pas à sa parole et s'opposa à tous ses projets, à la fois par de bonnes et par de mauvaises raisons. Enfin, elle fit une telle guerre au ministre, qu'elle décida sa chute ; il fut remplacé par Loménie de Brienne, archevêque de Sens.
Celui-ci, malgré ses prétentions, ne réussit pas mieux que son prédécesseur. Bientôt la Cour aux abois n'eut plus d'autre ressource que de rappeler Necker, et de convoquer les Etats généraux.
On donnait le nom d'Etats généraux, sous l'ancienne monarchie, à des assemblées représentatives et électives, convoquées par le roi, et ayant pour objet de voter des subsides et de présenter des vœux.
Il était admis en principe, quoiqu'on oubliât ce principe dans l'application, que nul impôt ne pouvait être levé sur les peuples sans leur consentement.
En retour de l'argent voté par les Etats, on leur permettait de présenter leurs vœux ou doléances, et de demander le redressement des griefs dont ils pouvaient avoir à se plaindre.
Le roi prenait l'argent ; quand aux vœux ou doléances, il n'y donnait satisfaction que dans la mesure qui lui convenait. Il restait maître d'accorder ou de refuser les demandes des populations.
Les Etats généraux ne se rassemblaient que sur la convocation du roi, et n'eurent jamais, comme le Parlement d'Angleterre, de réunions régulières et périodiques.
Les Etats généraux n'étaient pas, d'ailleurs, la vraie représentation de la nation, mais seulement des trois ordres, noblesse, clergé, tiers état, chacun d'eux nommant ses députés et votant séparément. Les ordres privilégiés étaient donc toujours deux contre un. Le tiers, inférieur aux deux autres, ne présentait ses doléances qu'à genoux : signe de son origine servile.
Les premiers Etats généraux furent réunis en 1302, et soutinrent le roi Philippe le Bel dans sa lutte contre le pape Boniface VIII.
Les derniers Etats généraux, avant 89, furent ceux de 1614, sous la régence de Marie de Médicis, pendant la minorité de Louis XIII.
A partir de cette époque jusqu'en 89, toute convocation d'Etats fut interrompue : ce fut donc 175 ans pendant lesquels il n'y eut en France aucun vestige de représentation nationale. Pendant la Fronde même, où le pouvoir royal vit s'élever contre lui l'opposition violente du parlement et de la noblesse, ‘est à peine si quelques voix réclamèrent l'intervention des Etats dans les affaires publiques : tant on était éloigné en France de reconnaître le droit du peuple à se gouverner lui-même et à surveiller la gestion des affaires.
Plusieurs fois cependant, entre 1302 et 1614, les Etats généraux, profitant des désordres où le malheur des temps avait jeté le pays, essayèrent de transformer leur pouvoir viager et éphémère en un pouvoir régulier et efficace. Jamais cette révolution ne fut plus près de s'accomplir qu'en 1356 et 1357, lors de la captivité du roi Jean en Angleterre, et sous la régence de son fils, depuis Charles V.
A cette époque, les Etats de Paris furent sur le point de faire triompher les principes essentiels de tout gouvernement libre : vote des impôts, convocations périodique des agents du pouvoir, etc. Cette tentative échoua, et la liberté politique fut ajournée pour des siècles.
Telle était l'institution que la monarchie, à bout de ressources, appelait à son secours en 1789, se promettant bien de ne s'en servir que pour obtenir l'argent nécessaire au rétablissement des finances, mais forcée bientôt de lui faire la part de plus en plus large, et de consentir avec elle au partage de la souveraineté.
Déjà le ministre Necker avait obtenu du roi une concession des plus graves et qui devait avoir les plus grandes conséquences. Dans les Etats antérieurs, le nombre des députés attribués au tiers état, n'avait jamais été rigoureusement fixé, et il avait toujours varié d'époque en époque. On décida que, dans la nouvelle assemblée, il serait égal en nombre aux deux ordres pris ensemble : c'est ce qu'on appela le doublement du tiers.
Ce n'était pas encore la prépondérance, mais c'était l'égalité. Le tiers se chargerait bientôt de faire le reste, et de montrer qu'il était la nation.
Les Etats généraux se réunirent le 5 mai à Versailles, au milieu de la joie et de l'espérance universelles. Le discours du roi parut assez peu en rapport avec ces espérances, et manifesta plus de crainte des innovations que de bonne volonté pour les réformes.
Le ministre ne parlait que de besoins financiers, sans dire un mot des réformes politiques que tout le monde attendait. Mais la nation n'était pas disposée cette fois à donner son argent sans compensation et sans s'assurer pour l'avenir des garanties durables.
Les Etats généraux ne conservèrent pas longtemps ce nom, qui appartenait au régime que l'on voulait détruire. Ils prirent le nom d'Assemblée nationale. Comment se fit ce changement qui était à lui seul toute la Révolution ?
La première opération de toute assemblée élective est de vérifier ses pouvoirs, c'est-à-dire de s'assurer que tous les membres qui la composent ont été sincèrement et légitimement élus.
Les Etats généraux durent donc procéder à la vérification des pouvoirs. Mais comment cette vérification aurait-elle lieu ? En commun, ou séparément ? En commun, c'était décider qu'ils ne formaient qu'une seule et même assemblée, sans distinction d'ordre ni de classe ; séparément, c'était maintenir la distinction des corps privilégiés et du peuple.
Une autre question était engagée dans celle-là : celle du vote par ordre ou du vote par tête. Si l'on se réunissait pour la vérification, c'était le principe du vote par tête qui l'emportait pour toute la durée des Etats ; si la séparation, au contraire, était maintenue, c'était le vote par ordre qui avait l'avantage.
Or, cette question du mode de votation était capitale ; car si l'on votait par ordre, les deux ordres étaient deux contre un ; si l'on votait par tête, le tiers état, qui était déjà égal et même un peu supérieur en nombre aux deux autres réunis, et qui avait dans chacun d'eux des adhérents, était sûr de la majorité.
Ce fut le Tiers qui l'emporta par sa persistance et sa ténacité.
Il refusa de procéder à la vérification de ses propres pouvoirs, tant que les deux autres corps ne seraient pas réunis à lui. Puis, après avoir attendu pendant un mois la réponse des privilégiés, il se décida à se passer d'eux ; et ce fut alors, le 17 juin, que le tiers état, sur la proposition de l'abbé Sieyès, se proclama Assemblée nationale et commença à agir en cette qualité.
La cour, irritée, prépara un coup d'Etat : fermant la salle des délibérations, elle en interdit l'entrée aux députés. Ils se transportèrent alors, sous a présidence de Bailly, dans la salle du Jeu de Paume ; et ce fut là, le 20 juin, qu'eu lieu cette séance mémorable, où tous prêtèrent solennellement serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une Constitution au pays.
La cour ne se tint pas pour battue ; et, profitant d'une absence de Necker, toujours disposé à la conciliation, elle décida Louis XVI à tenir une séance royale, comme on l'appelait, où il devait faire connaître sa volonté.
La séance royale eut lieu le 23 juin. Le roi donna ordre aux députés du tiers de cesser leurs séances. Il cassa leurs arrêtés, enjoignit de maintenir la distinction des ordres, et menaça les Etats de dissolution, si l'on méconnaissait ses volontés.
Ce discours hautain fut le dernier soupir de l'autorité royale. Le tiers continua ses séances malgré les injonctions du roi. C'est dans cette circonstance que, M. de Dreux-Brézé étant venu, de la part du roi, inviter les députés à se séparer, Mirabeau lui adressa cette apostrophe célèbre : « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. »
Le clergé bientôt vint se réunir au tiers état ; quelques députés de la noblesse vinrent aussi l'un après l'autre, et le roi lui-même se vit bientôt obligé d'inviter les ordres privilégiés à cesser toute résistance.
Ainsi s'accomplit la réunion des ordres, et leur absorption dans le tiers état ; ainsi fut décidée la question du vote par tête, qui assurait la souveraineté du tiers. Ainsi les Etats généraux devinrent Assemblée nationale.
Mais ce dernier titre lui-même n'est pas celui qui la désigne dans l'histoire. Ayant décidé de donner une Constitution à la France, elle prit, le 9 juillet, et a conservé le nom d'Assemblée constituante.
La cour avait été obligée de céder devant les Etats généraux, devenus Assemblée nationale. Les trois ordres s'étaient confondus dans la nation. La souveraineté s'était déplacée. La Révolution était faite. Si les privilégiés et la Cour eussent accepté définitivement cette situation, peut-être la conciliation eut-elle pu avoir lieu sans effusion de sang.
Il n'en fut pas ainsi. La cour voulut prendre sa revanche. Elle fit appel à la force, et fut vaincue par la force. A la révolution parlementaire succéda la révolution populaire. Telle fut, en deux mots, l'histoire du 14 juillet, date de l'un des plus grands évènements de la Révolution : la prise de la Bastille.
Des troupes avaient été appelées à Versailles de toutes parts. Necker était exilé, le ministère complètement renouvelé et remplacé par des ennemis des réformes « Le nouveau ministère ne dura que quelques jours. Breteuil remplaçait Necker et était le principal ministre. ». On espérait contenir Versailles et Paris, transférer l'Assemblée dans un lieu plus à l'abri des émotions populaires, et la tenir ainsi à merci.
A ces nouvelles, un immense mouvement de résistance se déclara dans l'Assemblée et dans le peuple. A l'Assemblée, Mirabeau, le redoutable tribun, fit voter une adresse au roi pour demander le renvoi des troupes. Au Palais-Royal, un jeune homme, alors inconnu, depuis célèbre, Camille Desmoulins, donna le signal de l'insurrection. Les troupes étrangères du régiment de Royal-Allemand firent feu sur la multitude. Les gardes françaises prirent parti pour le peuple.
Ce n'était que les préludes de la révolte. Elle prit bientôt une allure plus régulière et un but précis. Ce but, e fut l'attaque de la Bastille.
La Bastille, forteresse formidable, établie sur la place qui porte aujourd'hui ce nom, était une prison d'Etat, et en quelque sorte la citadelle de l'arbitraire. Là, sur de simples lettres de cachet, sans autre garantie de justice que la volonté royale, on renfermait et on laissait périr oubliés ceux qui avaient le malheur de déplaire au roi ou à ses favoris.
Le peuple, à peine armé, osa tenter le siège de la forteresse. La hache brisa les ponts-levis et les portes, et la population révoltée, soutenue par les gardes françaises, força ce vieil asile de servitude et de terreur qui, il faut le dire, n'était qu'assez faiblement défendu.
Ce fut la première insurrection victorieuse, la première apparition du peuple de Paris sur la scène révolutionnaire.
La royauté, qui n'avait pas voulu céder à la raison, fut contrainte de céder à la force. Le roi rappela Necker et les ministres, ordonna l'éloignement des troupes, se confia à l'Assemblée nationale, et vint à Paris recevoir des mains du célèbre Bailly, devenu maire de Paris, les clefs de la ville et la cocarde tricolore « A la suite du 14 juillet, une municipalité s'était organisée à l'hôtel de Ville et avait nommé Bailly, maire de Paris. En même temps, la garde nationale s'était spontanément organisée sous le commandement du général La Fayette. ». Ce fut, en apparence, un moment de réconciliation et de paix, mais qui ne devait pas durer longtemps.
Le 14 juillet avait été la défaite de la royauté. Le 4 Août fut l'abdication de la féodalité.
Dans cette nuit mémorable, l'Assemblée nationale abolit tous les privilèges. Dans un moment d'enthousiasme, la noblesse elle-même et le clergé, entraînés par l'esprit du temps, firent le sacrifice volontaire des droits abusifs et oppressifs qu'ils possédaient depuis des siècles.
Le vicomte de Noailles, ouvrant le feu, demanda l'égalité dans l'impôt, l'abolition des droits féodaux moyennant rachat, l'abolition sans rachat des corvées seigneuriales, des mainmortes, des servitudes personnelles « Les droits féodaux étaient considérés par la noblesse comme une propriété : c'est pourquoi elle demandait le rachat. Les corvées, les mainmortes et servitudes personnelles, étant au contraire des usurpations sur les libertés naturelles de l'homme, devaient être abolies sans rachat. ».
Guiche et Mortemart demandent l'abolition des pensions de Cour ; Virieu, l'abolition des colombiers ; l'évêque de Chartres, l'abolition du droit de chasse, jusque-là réservé aux seigneurs.
L'évêque de Nancy, au nom du clergé, demande à son tour le rachat des féodalités ecclésiastiques, à condition que le prix de rachat serait transformé en dotation appliquée au soulagement des pauvres.
Le curé Thibault, allant plus loin encore, offre l'abolition du casuel des prêtres. Mais l'Assemblée, tout en applaudissant, refusa ce sacrifice.
Tous les privilèges devaient disparaître à la fois dans cet entraînement universel. Un conseiller du Parlement propose l'abolition de la vénalité des charges et des autres privilèges de la magistrature.
Les villes elles-mêmes et les provinces tiennent à honneur de faire le sacrifice de tout ce qui les sépare, et les empêche de former une seule nation sous une seule loi. Suppression des barrières provinciales, plus de pays d'états.
En résumé : Abolition de la servitude personnelle et de la mainmorte. Abolition des corvées. Abolition des droits féodaux, sauf rachat pour certains d'entre eux. Faculté de rembourser les droits seigneuriaux. Abolition des justices seigneuriales. Abolition du droit exclusif de chasse, de colombier et de garenne. Taxe en argent représentative de la dîme. Rachat possible de toutes les dîmes « Plus tard, le clergé fit abandon du droit de rachat des dîmes, s'en rapportant à la nation du soin d'assurer les besoins du culte divin. ». Abolition de toute immunité pécuniaire, égalité d'impôts. Admissibilité de tous les citoyens aux emplois civils et militaires. Abolition des privilèges particuliers des provinces et des villes. Suppression de la vénalité des offices et établissement prochain d'une justice gratuite. Suppression des pensions de Cour, etc.
Tels sont les résultat qui, en une seule nuit, ont été conquis par la Révolution. C'est aux philosophes du XVIII° siècle, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Turgot, qu'il faut, en grande partie, faire honneur de cet immense changement dans les conditions de la vie sociale. Les philosophes ont proclamé les principes. L'Assemblée constituante a décrété l'application.
Toutes ces réformes peuvent se résumer en un seul mot : L'égalité devant la loi.
La nuit du 4 août avait été un moment d'exaltation et d'entraînement. Il restait à rédiger toutes les propositions décrétées, et à les consacrer par un acte fondamental et solennel destiné à être la pierre angulaire du monument nouveau que l'on allait élever. C'est ce que fit l'Assemblée nationale dans le préambule de sa constitution, sous ce titre : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
On a reproché à l'Assemblée constituante d'avoir fait précéder un acte constitutionnel d'une déclaration philosophique de principe. Cependant cette déclaration est précisément, de tous les actes de la Constituante, la seule chose qui soit restée immobile et respectée. La constitution péri, ainsi que toutes celles qui ont suivi. La Déclaration des droits a traversé tous les régimes, plus ou moins atteinte sans doute par les uns ou par les autres, mais demeurant, dans son ensemble, la base inébranlable du droit public de la France.
Rapportons donc ici textuellement les principaux articles de cette pièce mémorable, qui est, en quelque sorte, l'Evangile de l'ordre nouveau :
« Les représentant français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaltérables et sacrés de l'homme…En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence de tous et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants :
I. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
II. …Ces droits sont : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
III. Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
IV. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par une loi.
V. …
VI. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentant à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens sont égaux à ses yeux. Tous sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leur capacité.
VII. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans le cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
VIII. La loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires ; et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit.
IX. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable.
X. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre établi par loi.
XI. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
XII. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite l'établissement d'une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
XIII. Pour l'entretien de la force publique et les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
XIV. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-même ou leurs représentants, la nécessité de ces contributions publiques, de les consentir librement et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
XV. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
XVI. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution.
XVII. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique en est légalement constatée, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Après avoir posé ces principes, les auteurs de la constitution les résumaient en les ramenant aux deux idées fondamentales de l'égalité et de la liberté. ( Constitution de 91, titre 1er.).
L'égalité comprenait : 1° l'égale admissibilité aux emplois ; 2° l'égalité des impôts ; 3° l'égalité des peines.
La liberté comprenait : 1° la liberté personnelle, ou droit d'aller et venir, d'où dérive la liberté du travail et la liberté des propriétés ; 2° la liberté de pensée et de conscience ; 3° la liberté de réunion ; 4° la liberté de pétition.
Telles sont les maximes fondamentales d l'ordre social établi par la Révolution de 89. Elles ont été plus ou moins explicitement reconnues par tous les gouvernements issus de la Révolution. Elles sont donc la part la plus solide et la plus durable de l'œuvre accomplie par l'Assemblée constituante. Restait à établir l'organisation administrative et l'organisation politique du pays. Elle fut moins heureuse dans cette double entreprise.
DOCUMENTATION : Lien vers le texte complet des Droits de l'Homme.
La Révolution s'est faite à la fois sur deux théâtres différents : à l'Assemblée et dans la rue ; d'un côté par des décrets et des actes constitutionnels, de l'autre par des mouvements populaires ; le Serment du Jeu de paume, et la prise de la Bastille ; la nuit du 4 août et les journées d'octobre.
Le 14 juillet avait été la défaite de la royauté ; les 5 et 6 Octobre furent son humiliation et le commencement de sa déchéance. Le 14 Juillet avait abattu la citadelle du despotisme ; les journées d'octobre ramenèrent le roi à Paris, et le placèrent sous la garde et sous la menace du peuple.
Les anciens rois de France avaient fait de Paris le siège de leur pouvoir. Le Palais de Justice, l'Hôtel de Saint-Paul, le Louvre avaient été successivement des demeures royales. Louis XIV, le premier, dans son ressentiment des injures qu'avaient infligées à sa mère et à lui-même les Parisiens pendant la Fronde, avait quitté Paris pour n'y plus rentrer, et avait fait de Saint-Germain d'abord, de Versailles ensuite, le siège de son gouvernement et de sa Cour, en ornant cette dernière résidence de toutes les splendeurs de l'art et du goût. Depuis lui, Louis XV, sauf pendant la régence du duc d'Orléans, et louis XVI, ses successeurs, avaient continué d'habiter ce majestueux séjour.
Après le 14 Juillet, Paris avait appelé à sa tête, pour maire Bailly, le savant illustre, et pour commandant des gardes nationales La Fayette, si populaire alors pour ses opinions libérales et généreuses, et pour la part qu'il avait prise, avec Washington, à l'émancipation des Etats-Unis d'Amérique.
Etait-ce Paris, était-ce Versailles qui devait l'emporter ?
La Cour n'avait pas accepté la défaite du 14 juillet. Elle voulut prendre sa revanche et appela de nouveau des troupes à son secours. Elle avait négocié avec le marquis de Bouillé un projet de fuite. Les gardes du roi avaient invité à un banquet, dans la salle de spectacle du château de Versailles, les officiers des autres corps. A ce banquet, des chants, des toast, la reine venant après la fête remercier ses défenseurs, la cocarde tricolore foulée au pieds, tout semblait indiquer une pensée de réaction.
Excité déjà par les discutions de l'Assemblée sur le veto royal, par les résistances du roi aux décrets du 4 août ; surexcité encore par la disette, le courroux populaire s'exalta à ces événements.
Les femmes de Paris, conduites par Maillard, célèbre depuis par les massacres de septembre, marchèrent sur Versailles. Les gardes nationaux, commandés par La Fayette, arrivèrent à leur tour. Celui-ci réussit à rétablir l'ordre et le calme. Mais pendant la nuit un malentendu vint détruire son œuvre ; le château fut envahi. La reine fut obligée d'avoir recours à la protection de La Fayette, qu'elle détestait ; les gardes du corps furent sauvés par la même protection. La victoire resta à la multitude ; et le roi et la reine rentrèrent acclamés, mais prisonniers, à Paris.
Dès ce jour, Paris redevint la capitale de la France, et Versailles demeura avec sa grandeur déserte et sa majesté silencieuse et glacée.