DU VRAI
DU BEAU & DU BIEN
PAR
VICTOR COUSIN
Texte commenté par
ANDRE Pierre Jocelyn
DISCOURS
Prononcé à l'ouverture du cours
Le 4 décembre 1817
joris Abadie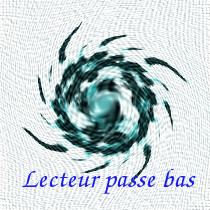
DU VRAI
DU BEAU & DU BIEN
VICTOR COUSIN
Texte commenté par
ANDRE Pierre Jocelyn
Prononcé à l'ouverture du cours
Le 4 décembre 1817
joris Abadie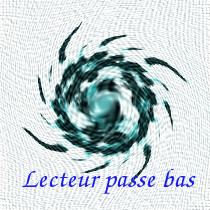
De la philosophie au XIX° siècle
Esprit du cours. Nous relevons de Descartes et de sa méthode, la méthode psychologique ; progrès de cette méthode du XVII° au XVIII° siècle.Qu'elle est commune aux diverses écoles que le XVIII° siècle nous a léguées et qu'elle en fait l'unité. Formation naturelle d'un nouvel éclectisme. - Application de ces vues générales aux trois problèmes du vrai, du beau et du bien, qui composent la philosophie tout entière. Sur ces trois problèmes, nous serons tour à tour et dans une juste mesure pour et contre Locke, Reid et Kant. - Eclectisme et spiritualisme. Que l'éclectisme est la lumière de l'histoire de la philosophie, mais que lui-même suppose une théorie qui y préside, et que cette théorie est le spiritualisme, but suprême de tous nos travaux.
Il semble assez naturel qu'un siècle à ses débuts emprunte sa philosophie au siècle qui précède. Mais, comme êtres intelligents et libres, nous ne sommes pas nés pour continuer seulement nos devanciers, mais pour accroître leur oeuvre et faire aussi la nôtre. Nous ne pouvons accepter leur héritage que sous bénéfice d'inventaire. Notre premier devoir est donc de nous rendre compte de la philosophie du XVIII° siècle, de reconnaître son caractère et ses principes, les problèmes qu'elle agitait et les solutions qu'elle en a données, de discerner enfin ce qu'elle nous transmet de vrai et de fécond, et ce qu'elle laisse aussi de stérile et de faux, pour embrasser l'un et rejeter l'autre d'un chois réfléchi. Placés à l'entrée de temps nouveaux, sachons avant tout dans qu'elles voies nous nous voulons engager. Pourquoi, d'ailleurs, ne le dirions-nous pas ? Après deux années d'un enseignement où le professeur se cherchait en quelque sorte lui-même, on a bien le droit de lui demander quel il est, quels sont ses principes les plus généraux sur toutes les parties essentielles de la sciences philosophique, quel drapeau enfin, au milieu de partis qui se combattent si violemment, il vous propose de suivre, jeunes gens qui fréquentez cet auditoire et qui êtes appelés à partager la destinée si incertaine encore du XIX° siècle.
Ce n'est pas le patriotisme, c'est le sentiment profond de la vérité et de la justice qui nous fait placer toute la philosophie aujourd'hui répandue dans le monde sous l'invocation du nom de Descartes. Oui, la philosophie moderne tout entière est l'oeuvre de ca grand homme : car elle lui doit l'esprit qui anime et la méthode qui fait sa puissance.
Après la chute de la scolastique et les déchirements douloureux du XIX° siècle, le premier objet que se proposa le bon sens hardi de Descartes fut de rendre la philosophie une science humaine, comme l'astronomie, la physiologie, la médecine, soumise aux mêmes incertitudes et aux mêmes égarements, mais capable aussi des mêmes progrès.
Descartes rencontra devant lui le scepticisme répandu de tous côtés à la suite de tant de révolutions, des hypothèses ambitieuses, nées du premier usage d'une liberté mal réglée, et les vieilles formules échappées à la ruine de la scolastique. Dans sa passion courageuse de la vérité, il résolut de rejeter, provisoirement au moins, toutes les idées qu'il avait reçues jusque-là sans les contrôler, bien décidé à ne plus admettre que celles qui, après un sérieux examen, lui paraîtraient évidentes. Mais il s'apperçut qu'il y avait une chose qu'il ne pouvait rejeter, même provisoirement, dans son doute universel : cette chose était l'existence même de son doute, c'est-à-dire de sa pensée ; car quand même tout le reste ne serait qu'illusion, ce fait, qu'il pensait, ne pouvait pas être une illusion. Descartes s'arrêta donc à ce fait, d'une évidence irrésistible, comme à la première vérité qu'il pouvait accepter sans crainte, et sur ce solide fondement il éleva une doctrine d'un caractère à la fois certain et vivant, capable de résister au scepticisme, exemple d'hypothèse, et affranchie des formules de l'écoles.
C'est ainsi que l'étude de la pensée et de l'esprit qui en est le sujet, c'est-à-dire la psychologie, est devenue le point de départ, le principe le plus général, la grande méthode de la philosophie moderne.
Toutefois, il faut bien l'avouer, la philosophie n'a pas entièrement perdu et elle reprend encore quelque-fois, après Descartes et dans Descartes même, ses anciennes habitudes. Il appartient rarement au même homme d'ouvrir et de parcourir la carrière, et d'ordinaire l'inventeur succombe sous le poids de sa propre invention. Ainsi Descartes, après avoir si bien posé le point de départ légitime de toute recherche philosophique, l'oublie plus d'une fois et revient, au moins dans la forme, à l'ancienne philosophie. La vraie méthode s'efface bien plus encore entre les mains de ses premiers successeurs, sous l'influence toujours croissante de la méthode mathématique.
On peut distinguer deux périodes dans l'ère cartésienne : l'une où la méthode, en sa nouveauté, est souvent méconnue ; l'autre où l'on s'efforce au moins de rentrer dans la voie salutaire ouverte par Descartes. A la première appartiennent Malebranche, Spinosa, Leibniz lui-même ; à la seconde, les philosophes du XVIII° siècle.
Sans doute Malebranche est, sur quelques points, descendu très-avant dans l'observation intérieure ; mais la plupart du temps il se laisse emporter dans un monde imaginaire, et il perd de vue le monde réel. Il en vient jusqu'à révoquer en doute l'autorité de la conscience, et par le renversement le plus étrange de l'ordre naturel, au lieu de chercher Dieu par l'intermédiaire de la nature et surtout de la pensée, comme Descartes, il croit l'atteindre directement, et c'est en Dieu qu'il voit toutes choses. Ce n'est pas une méthode qui manque à Spinoza, mais c'est la bonne. Son tort est d'avoir appliqué à la philosophie la méthode géométrique, qui procède par axiomes, définitions, théorèmes, corollaires ; nul n'a poins pratiqué la méthode psychologique : c'est là le principe et aussi la condamnation de son système. Les « Nouveaux Essais sur l'entendement humain » montrent Leibniz opposant observation à observation, analyse à analyse, conclusion à conclusion ; mais son génie plane ordinairement sur la science, au lieu de s'y avancer pas à pas : voilà pourquoi les résultats auxquels il arrive ne sont souvent que de brillantes hypothèses, par exemple l'armonie préétablie, qui n'est guère que le développement d'une autre hypothèse, celle des causes occasionnelles de Malebranche. Disons-le bien haut : il n'y a de durable que ce qui est fondé sur une saine méthode ; le temps emporte tout le reste ; le temps, qui recueille, feconde, agrandit les moindres germes de vérité déposés dans les plus humbles analyses, frappe sans pitié les ypothèses, mêmes celles du génie. Il fait un pas, et les systèmes arbitraires sont renversés ; les statues de leurs auteurs restent seules debout sur leurs ruines. La tâche de l'ami de la vérité est de rechercher les débrits utiles qui en subsistent, et peuvent servir à de nouvelles et plus solides constructions.
La philosophie du XVIII° siècle ouvre la seconde période de l'ère cartésienne ; elle se proposa surtout d'appliquer la méthode trouvée et trop négligée : elle s'attacha à l'analyse de la pensée. Désabusé de tentative ambitieuses et stériles, et dédaigneux du passé comme Descartes lui-même, le XVIII° siècle osa croire que tout était à refaire en philosophie, et que, pour ne pas s'égarer de nouveau, il fallait débuter par l'étude modeste de l'homme. Au lieu donc de bâtir tout d'un coup des systèmes hasardés sur l'universalité des choses, il entreprit d'examiner ce que l'home sait et ce qu'il peut savoir ; il ramena la philosophie entière à l'étude de nos facultés, comme la physique venait d'être ramenée à l'étude des propriétés des corps : c'était donner à la philosophie, sinon sa fin, du moins son vrai commencement.
Les grandes écoles qui partagent le XVIII° siècle sont l'école anglaise et française, l'école écossaise, l'école allemande, c'est-à-dire l'école de Locke et de Condillac, celle de Reid, celle de Kant. Il est impossible de méconnaître le principe commun qui les anime, l'unité de leur méthode. Quand on examine avec impartialité la méthode de Locke, on voit qu'elle consiste dans l'analyse de la pensée, et c'est par là que Locke est un disciple, non de Bacon et de Hobbes, mais de notre grand compatriote, de Descartes. Etudier l'entendement humain tel qu'il est en chacun de nous, reconnaître ses forces et aussi ses limites, tel est le problème que le philosophe anglais s'est proposé et qu'il essaie de résoudre. Nous ne jugeons pas ici la solution qu'il en donne ; nous nous bornons à bien marquer quel est pour lui le problème fondamental. Condillac, le disciple français de Locke, se fait partout l'apôtre de l'analyse ; et l'analyse, ici, c'est encore ou du moins ce devrait être l'étude de la pensée. Nul philosophe, pas même Spinoza, ne s'est plus éloigné que Condillac de la vraie méthode expériemntale, et ne s'est plus égaré dans la route des abstractions, et même des abstractions verbales ; mais, chose étrange, nul n'est plus sévère à l'endroit des hypothèses, sauf à aboutir à celle de l'homme-statue. L'auteur du « Traité des Sensations » a très-infidèlement pratiqué l'analyse, mais il en parle sans cesse. L'école écossaise combat Locke et Condillac ; elle les combat, mais avec leurs propres armes, avec la même méthode qu'elle prétend appliquer mieux. En Allemagne, Kant veut remettre en lumière et en bonheur l'élément supérieur de la connaissance humaine, laissé dans l'ombre ou décrié par la philosophie de son temps. Pour cela que fait-il ? Il entreprend un examen approfondi de la faculté de connaître ; son principal ouvrage a pour titre : « Critique de la raison pure » ; c'est donc encore une analyse ; en sorte qu'au fond la méthode de Kant n'est pas autre que celle de Locke et de Reid. Suivez-la jusque entre les mains de Fichte, le successeur de Kant, mort à peine depuis quelques années : là encore l'analyse de la pensée est donnée comme le fondement de la philosophie. Kant s'était si bien établi dans le sujet de la connaissance qu'il avait eu de la peine à en sortir, et qu'il n'en sortit même jamais légitimement. Fichte s'y ensevelit, et absorba dans le « moi » humain toutes les existences comme toutes les sciences : triste naufrage de l'analyse, qui en signale à la fois le plus grand effort et l'écueil !
Le même esprit gouverne donc toutes les écoles du XVIII° siècle : ce siècle dédaigne les formules abstraites ; il a horreur de l'hypothèse ; il s'attache ou prétend s'attacher à l'observation des faits, et particulièrement à l'analyse de la pensée.
Reconnaissons-le avec franchise et avec douleur : le XVIII° siècle a appliqué l'analyse à toutes choses sans pitié et sans mesure. Il a cité devant son tribunal toutes les doctrines, toutes les sciences ; ni la métaphysique de l'âge précédent avec ses systèmes imposants, ni les arts avec leur prestige, ni les gouvernements avec leur vieille autorité, ni les religions avec leur majesté, rien n'a trouvé grâce devant lui. Quoiqu'il entrevît des abîmes au fond de ce qu'il appelait la philosophie, il s'y est jeté avec un courage qui n'est pas sans grandeur ; car la grandeur de l'homme est de préférer ce qu'il croit la vérité à lui-même. Le XVIII° siècle a déchaîné les tempêtes. L'humanité n'a plus marché que sur des ruines. Le monde s'agite encore dans cet état de désordre où déjà il a été vu une fois, au déclin des croyances antiques et avant le triomphe du christianisme, quand l'homme errait à travers tous les contraires, sans pouvoir se reposer nulle part, livré à toutes les inquiétudes de l'esprit et à toutes les misères du coeur, fanatique et athée, mystique et incrédule, voluptueux et sanguinaire. Mais si la philosophie du dernier siècle nous a laissé le vide pour héritage, elle nous a laissé aussi un amour énergique et fécond de la vérité. Le XVIII° siècle a été l'âge de la critique et des destructions ; le XIX° doit être celui des réhabilitations intelligentes. Il lui appartient de trouver dans une analyse plus profonde de la pensée les principes de l'avenir, et avec tant de débris d'élever enfin un édifice que puisse avouer la raison.
Ouvrier faible, mais zélé, je viens apporter ma pierre ;je viens faire ma journée, je viens retirer du milieu des ruines ce qui n'a pas péri, ce qui ne peut pas périr. Ce cours est à la fois un retour sur le passé et un effort vers l'avenir, je ne me propose ni d'attaquer ni de défendre aucune des trois grandes écoles qui partagent le XVIII° siècle ; je ne chercherai point à perpétuer et à envenimer la guerre qui les divise, en signalant complaisamment les différences qui les séparent, sans tenir compte de la communauté de méthode qui les unit. Je viens, au contraire, soldat dévoué de la philosophie, ami commun de toutes les écoles qu'elle a produites, offrir à toutes des paroles de paix.
L'unité de la philosophie moderne réside, comme nous l'avons dit, dans sa méthode, c'est-à-dire dans l'analyse de la pensée, méthode supérieure à ses propres résultats, car elle contient en elle le moyen de réparer les erreurs qui lui échappent, et d'ajouter indéfiniment de nouvelles richesses aux richesses acquises. Les sciences physiques elles-mêmes n'ont pas d'autre unité. Les grands physiciens qui ont paru depuis deux siècles, bien qu'unis entre eux par le même point de départ et par le même but publiquement acceptés, n'en ont pas moins marché avec indépendance et dans des voies souvent opposées. Le temps a recueilli dans leurs diverses théories la part de vérité qui les a fait naître et qui les a soutenues ; il a négligé les erreurs auxquelles elles n'ont pu se soustraire, et, rattachant les unes aux autres toutes les découvertes dignes de ce nom, il en a formé peu à peu un ensemble vaste et harmonieux.La philosophie moderne s'est aussi enrichie depuis deux siècles d'une multitudes d'observations exactes, de théories solides et profondes ; dont elle est redevable à la commune méthode. Que lui a-t-il manqué pour marcher d'un pas égal avec les sciences physiques dont elle est la soeur ? Il lui a manqué d'entendre mieux ses intérêts, de tolérer des diversités inévitables, utiles même, et de mettre à profit les vérités que contiennent toutes les doctrines particulières pour en tirer une doctrine générale, qui s'épure et s'agrandisse successivement et perpétuellement.
Non, certes, que je conseille ce syncrétisme aveugle qui perdit l'école d'Alexandrie, et tentait de rapprocher forcément des systèmes contraires ; ce que je recommande, c'est un éclectisme éclairé qui, jugeant avec équité et même avec bienveillance toutes les écoles, leur emprunte ce qu'elles ont de vrai, et n'églige ce qu'elles ont de faux. Puisque l'esprit de parti nous a si mal réussi jusqu'à présent, essayons de l'esprit de conciliation. La pensée humaine est immense. Chaque école ne l'a considérée qu'à son point de vue. Ce point de vue n'est pas faux, mais il est incomplet, et, de plus, il est exclusif. Il n'exprime qu'un côté de la vérité, et rejette tous les autres. Il ne s'agit pas aujourd'hui de recommencer l'ouvrage de nos devanciers, mais de le perfectionner en réunissant et en fortifiant par cette réunion toutes les vérités éparses dans les différents systèmes que nous a transmis le XVIII° siècle.
Tel est le principe auquel peu à peu nous ont conduit deux années d'études sur la philosophie moderne depuis Descartes jusqu'à nos jours. Ce principe, mal dégagé d'abord et appliqué une première fois dans les limites les plus étroites, nous l'avons ensuite étendu à un plus grand nombre de questions et de théories ; et en même temps que nous poursuivions les recherches de notre illustre prédécesseur, M. Royer-Collard, sur les écoles de France, et d'Angleterre et d'Ecosse, nous avons commencé une étude nouvelle parmi nous, l'étude difficile, mais intéressante et féconde, du philosophe de Koenigsberg. Nous pouvons donc aujourd'hui embrasser toutes les écoles du XVIII° siècle et tous les problèmes qu'elles ont agités.
La philosophie, dans tous les temps, roule sur les idées fondamentales du vrai, du beau et du bien. L'idée du vrai, philosophiquement développée, c'est la psychologie, la logique, la métaphysique ; que l'idée du bien, c'est la morale privée et publique ; l'idée du beau, c'est cette science qu'en Allemagne on appelle l'esthétique, dont les détails regardent la critique littéraire et la critique des arts, mais dont les principes généraux ont toujours occupé une place plus ou moins considérable dans les recherches et même dans l'enseignement des philosophes, depuis Platon et Aristote jusqu'à Hutcheson et Kant.
Sur ces points essentiels qui composent le domaine entier de la philosophie, nous interrogerons successivement les principales écoles du XVIII° siècles.
Lorsqu'on les examine toutes avec attention, on les ramène aisément à deux : l'une qui, dans l'analyse de la pensée, sujet commun de tous les travaux, fait à la sensibilité une part excessive ; l'autre qui dans cette même analyse, se jetant à l'extrémité opposé, tire la connaissance presque tout entière d'une faculté différente de la sensibilité, la raison. La première de ces écoles est l'école empirique, dont le père ou plutôt le représentant le plus sage est Locke, et Condillac le représentant extrème ; la seconde est l'école spiritualiste, ou comme on voudra l'appeler, qui compte à son tour d'illustres interprètes : Reid, le plus irréprochable, Kant le plus systématique. Evidemment il y a du vrai dans ces écoles, et la vérité est un bien qu'il faut prendre partout où on le rencontre. Nous admettons volontiers avec l'école empirique que les sens ne nous ont pas été donnés en vain ; que cette admirable organisation, qui nous élève au-dessus de tous les êtres animés, est un instrument riche et varié qu'il serait insensé de négliger. Nous sommes convaincu que le spectacle du monde est un foyer permanent d'instruction saine et sublime. Sur ce point, ni Aristote, ni Bacon, ni Locke ne nous auront pour adversaire, mais pour disciple. Nous avouons ou plutôt nous proclamons que dans l'analyse de la connaissance humaine il faut faire aux sens une grande part. Mais quand l'école empirique prétend que tout ce qui passe leur portée est une chimère, alors nous l'abandonnons, et nous allons nous joindre à l'école opposée. Nous faisons profession de croire, par exemple, que, sans une impression agréable, jamais nous n'aurions conçu le beau, et que pourtant le beau n'est pas seulement l'agréable ; que, grâce à Dieu, le plaisir ou du moins le bonheur s'ajoute ordinairement à la vertu, mais que l'idée même de la vertu est esstiellement différente de celle du bonheur. Là-dessus nous sommes ouvertement de l'avis de Reid et de Kant. Nous avons aussi établi et nous établirons encore que l'esprit de l'homme est en possession de principe que la sensation précède mais n'explique point, et qui nous sont directement suggérés par la puissance propre de la raison. Nous suivrons Kant jusque-là, mais pas au-delà. Loin de le suivre, nous le combattrons, après avoir défendu victorieusement contre l'empirisme les grands principes en tout genre, il les frappe de stérilité en prétendant qu'ils n'ont aucune valeur au delà de l'enceinte de la raison qui les aperçoit, condamnant ainsi à l'impuissance cette même raison qu'il vient d'élever si haut, et ouvrant la porte à un scepticisme raffiné et savant qui, après tout, aboutit au même abîme que le scepticisme ordinaire.
Vous le voyez, nous serons tour à tour avec Locke, avec Reid et avec Kant dans cette juste et forte mesure qu'on appelle l'éclectisme.
L'éclectisme est à nos yeux la vraie méthode historique, et il a pour nous toute l'importance de l'histoire de la philosophie ; mais il y a quelque chose que nous mettons encore au-dessus de l'histoire de la philosophie : c'est la philosophie elle-même.
L'histoire de la philosophie ne porte pas sa clarté avec elle-même, et elle n'est point son propre but.
Il est juste sans doute, il est de la plus haute utilité de bien discerner dans chaque système ce qu'il a de vrai d'avec ce qu'il a de faux, d'abord pour bien apprécier ce système, ensuite pour rendre le faux au néant, dégager et recueillir le vrai, et ainsi enrichir et agrandir la philosophie par l'histoire. Mais vous concevez qu'ilfaut savoir déjà quelle est la vérité, pour la reconnaître quelque part et la distinguer de l'erreur qui y est mêlée ; d'où il suit que la critique des systèmes exige presque un système, et que l'histoire de la philosophie est contrainte d'emprunter d'abord à la philosophie la lumière qu'elle doit lui rendre un jour avec usure.
Enfin l'histoire de la philosophie n'est qu'une branche ou plutôt un instrument de la science philosophique. C'est l'intérêt que nous portons à la philosophie qui nous attache à son histoire ; c'est l'amour de la vérité qui nous fait poursuivre partout ses vestiges, et interroger avec une curiosité passionnée ceux qui avant nous ont aimé aussi et cherché la vérité.
Ainsi la philosophie est à la fois l'objet suprême et le flambeau de l'histoire de la philosophie. A ce double titre, il lui appartient de présider à notre enseignement.
A cet égard, un mot d'explication, je vous prie. Celui qui porte aujourd'hui la parole devant vous n'est, il est vrai, chargé que du cours de l'histoire de la philosophie ; là est notre tâche, et là, encore une fois, notre guide sera l'éclectisme. Mais nous le confessons, si la philosophie n'a pas droit de se présenter ici, en quelque sorte, sur le premier plan, si elle n'y paraît que derrière son histoire, en réalité elle y domine, et c'est à elle que se rapportent tous nos voeux comme tous nos efforts. Nous tenons sans doute en très-grande estime et Brucker et Tennemann, si savants, si judicieux ; cependant nos modèles, nos véritable maîtres, toujours présents à notre pensée, ce sont dans l'antiquité Platon et Socrate, chez les modernes Descartes, et, n'hésitons pas à le dire, c'est chez nous et dans notre temps, l'homme illustre qui a bien voulu nous appeler à cette chaire M. Royer-Collard n'était aussi qu'un professeur de l'histoire de la philosophie ; mais il prétendait bien avoir une opinion en philosophie : il servait une cause qu'il nous a transmise, et nous la servons à notre tour.
Cette grande cause vous est connue : c'est celle d'une philosophie saine et généreuse, digne de notre siècle par la sévérité de ses méthodes et répondant aux besoins immortels de l'humanité, partant modestement de la psychologie, de l'humble étude de l'esprit humain, pour s'élever aux plus hautes régions et parcourir la métaphysique, l'esthétique, la théodicée, la morale et la politique.
Notre entreprise n'est donc pas seulement de renouveler l'histoire de la philosophie par l'éclectisme ; nous voulons aussi, nous voulons surtout, et l'histoire bien entendue, grâce à l'éclectisme, nous y servira puissamment, faire sortir de l'étude des systèmes, de leurs luttes, de leurs ruines même, un système qui soit à l'épreuve de la critique, et qui puisse être accepté par votre raison et aussi par votre coeur, noble jeunesse du XIX° siècle !
Pour remplir ce grand objet, qui est notre mission véritable, nous oserons cette année, pour la première et pour la dernière fois, franchir les limites qui nous sont d'ordinaire imposées. Nous avons résolu de laisser un peu dans l'ombre l'histoire de la philosophie pour faire paraître la philosophie elle-même, et, tout en mettant sous vos yeux les traits distinctifs des principales doctrines du siècle qui nous précède, de vous exposer celle qui nous semble convenir aux besoins et à l'esprit de notre temps, et encore de vous l'exposer brièvement, mais dans toute son étandue, au lieu d'insister sur quelqu'une de ses parties, ainsi que nous l'avons fait jusqu'ici. Avec les années, nous corrigerons, nous tâcherons d'agrandir et d'élever notre oeuvre. Aujourd'hui nous vous la présentons bien imparfaite encore, mais établie sur des fondements que nous croyons solides, et déjà marquée d'un caractère qui ne changera point.
Vous verrez donc ici, rassemblés en un court espace, nos principes, nos procédés, nos résultats. Nous souhaitons ardemment vous les persuader, jeunes gens, qui êtes à la fois l'espérance de la science et de la patrie. Puissions-nous du moins, dans la vaste carrière que nous avons à parcourir ensemble, rencontrer en vous la même bienveillance qui jusqu'à présent nous a soutenu !